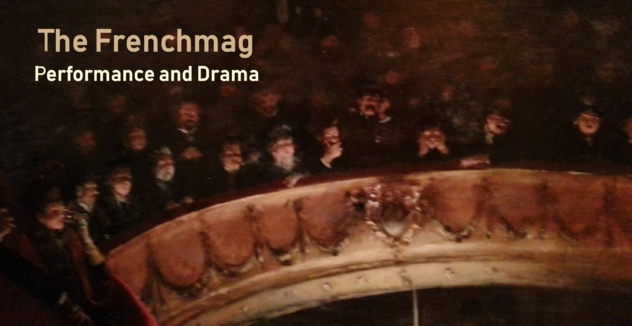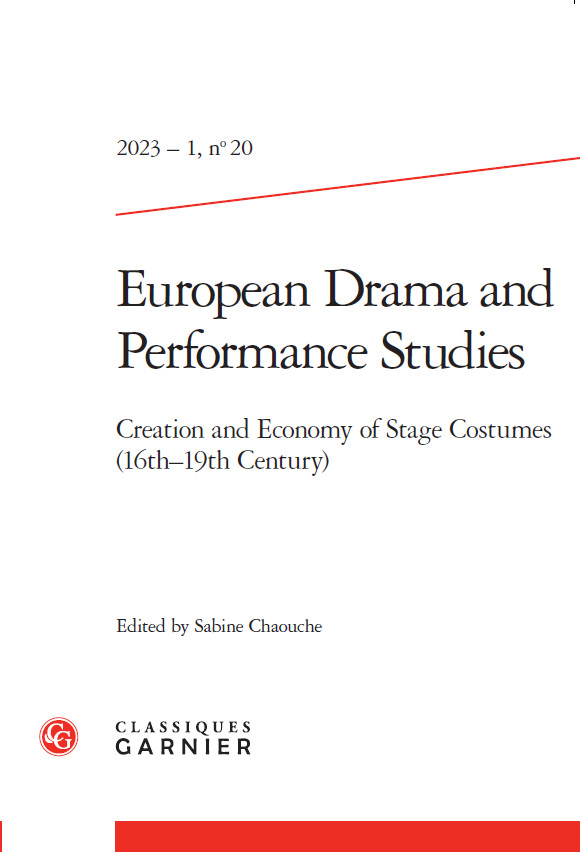« je remarque le vieillissement, l’inutilité croissante, le fait que rapidement nous en avons assez de la comédie de l’existence, de tout l’art dramatique… un beau jour, au moment unique et décisif, nous nous jetons tête la première dans la mort… » (1)
Introduction. … revoir la mort
Place des Héros clôt la théâtrographie de Thomas Bernhard. L’auteur autrichien fait sa dernière apparition publique à la première le 4 novembre 1988 devant une foule partagée entre applaudissements et huées. À l’occasion du « Bedenkjahr », cinquante ans après l’Anschluss, le metteur en scène Claus Peymann demande à Bernard d’écrire une pièce pour le centième anniversaire du Burgtheater de Vienne dont il est alors directeur artistique. Place des Héros est son dernier mot sur l’Autriche contemporaine, sans compter son testament interdisant toute diffusion et représentation de ses œuvres dans son pays natal. Dans cette pièce-rétrospective, qui peut être considérée notamment comme une réflexion sur l’histoire et la mémoire de l’Autriche nazie, les personnages de la pièce et sans doute, en partie, Bernhard à travers eux, critiquent l’immobilisme de l’Autriche. Le personnage de Madame Zittel, la gouvernante du professeur de mathématiques juif Josef Schuster, le suicidé, cite ce dernier en ouverture de la pièce : « Maintenant tout est encore bien pire / qu’il y a cinquante ans disait-il » (2).
Josef Schuster s’est jeté par la fenêtre de son appartement donnant sur la Place des Héros à Vienne, lieu où Hitler était acclamé par la foule cinquante ans plus tôt, lors de sa proclamation de l’annexion de l’Autriche au Troisième Reich. La pièce en trois scènes se déroule le jour des funérailles du professeur et découvre le noyau intime de celui-ci. Son frère, le professeur de philosophie Robert Schuster, son alter ego, fait part comme par procuration du désarroi de Josef Schuster devant la société autrichienne, ressentiment qu’il partage. Robert Schuster a choisi la vie un peu par hasard, il approuve le geste de son frère : « Quel homme enviable tout de même que celui / qui a eu la force / de se sauver de ce monstre d’État en plongeant dans la fin absolue / et tout simplement dans le cimetière de Döbling » (3). La vie de Robert n’est pas à prendre en exemple, mais au contraire, sa survie, en tragédie : « Le tragique en fait n’est pas / que mon frère soit mort / que nous soyons restés voilà ce qui est / effroyable » (4). Robert Schuster n’est que porteur de la parole désespérée de son frère, voilà la seule valeur accordée à sa vie comme le remarque Chantal Thomas à propos du narrateur du roman Le Naufragé (1986), ami du suicidé Wertheimer : « la survie n’est rien d’autre que d’être le narrateur » (5). Bien qu’elle n’apparaisse qu’à la fin de la pièce, Madame Schuster est sur toutes les lèvres des autres personnages et hante la scène, tout comme les costumes et les valises du professeur Schuster qui devaient être envoyés à Oxford, mais qui encombrent encore l’appartement. L’état dépressif et les hallucinations auditives de Madame Schuster, qui entend depuis plus de dix ans les clameurs de la foule de la Place des Héros en 1938, posent l’événement historique et ses répercussions ainsi que leur mode d’apparition, le trauma, comme problématiques centrales de la pièce.
Même après que le procès Eichmann et celui de Francfort ont attesté de la responsabilité du pays annexé dans les crimes nazis, l’Autriche de 1988 se perçoit encore généralement comme une victime du Troisième Reich (6). La pièce provoque un débat, ou plutôt, un scandale, en ce qu’elle adopte la position inverse, doublée d’un pessimisme radical, voire outrancier. Le parti pris de Bernhard est nourri, tout comme celui de ses détracteurs est gêné, par le cas Kurt Waldheim et l’élection récente de Jörg Haider comme président du Parti de la Liberté d’Autriche (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ) (1986) (7). Place des Héros annihile toute vision ou espoir pour l’avenir de l’Autriche, ce « cloaque sans esprit ni culture » (8) où le « malheur autrichien » (9) ne semble pouvoir que tourner en boucle. L’auteur offre une image de son pays englué dans un statisme obtus et une aliénation sans appel, et, pour comble, enracine l’identité autrichienne même dans l’antisémitisme à travers les mots de Robert Schuster : « la haine du juif est la nature la plus pure absolument authentique / de l’Autrichien » (10).
Le présent est figé, tel le corps de Josef Schuster gisant sur la Place des Héros, que Herta la bonne persiste à regarder par la fenêtre, bien qu’il ait disparu. Le passé revient de manière lancinante par les mots de Josef Schuster que les personnages échangent en dialogues de sourds ou encore par la répétition en leitmotive de fragments de texte tout au long de la pièce. Autant de perturbations qui mettent en doute les notions de début et de fin, de renouveau et de deuil. Là aussi est-il possible de voir une raison supplémentaire à la polémique créée par la pièce à sa parution. Bernhard aurait touché à une corde particulièrement sensible chez la génération de l’après-guerre selon Dagmar Lorenz, soit l’angoisse de la « confrontation au passé » et des « ajustements pour le futur » (11). Bernhard qualifie son théâtre comme étant dépourvu de « saut périlleux » (12), il serait une antithèse du théâtre de péripéties. Le seul « saut » est effectivement celui de Josef Schuster, et il a lieu avant même que le rideau ne se lève. Dans cette pièce de l’après, du refus de l’événement, de tout événement, il n’est donc point question de représentation de l’acte suicidaire de Josef Schuster comme tel, pourtant il est au centre de chaque scène. Son suicide rend sensible cette cohabitation bernhardienne de la vie et de la mort et donne lieu par là à une remise en question des limites que ces dernières constituent pour l’existence ainsi que de la valeur et du sens accordés au temps. Il se pose aux côtés de la vie et de la mort comme un pôle existentiel à part entière, celui de l’esthétique, et met en lumière le caractère théâtral de la vie.
Josef Schuster s’est jeté par la fenêtre de son appartement donnant sur la Place des Héros à Vienne, lieu où Hitler était acclamé par la foule cinquante ans plus tôt, lors de sa proclamation de l’annexion de l’Autriche au Troisième Reich. La pièce en trois scènes se déroule le jour des funérailles du professeur et découvre le noyau intime de celui-ci. Son frère, le professeur de philosophie Robert Schuster, son alter ego, fait part comme par procuration du désarroi de Josef Schuster devant la société autrichienne, ressentiment qu’il partage. Robert Schuster a choisi la vie un peu par hasard, il approuve le geste de son frère : « Quel homme enviable tout de même que celui / qui a eu la force / de se sauver de ce monstre d’État en plongeant dans la fin absolue / et tout simplement dans le cimetière de Döbling » (3). La vie de Robert n’est pas à prendre en exemple, mais au contraire, sa survie, en tragédie : « Le tragique en fait n’est pas / que mon frère soit mort / que nous soyons restés voilà ce qui est / effroyable » (4). Robert Schuster n’est que porteur de la parole désespérée de son frère, voilà la seule valeur accordée à sa vie comme le remarque Chantal Thomas à propos du narrateur du roman Le Naufragé (1986), ami du suicidé Wertheimer : « la survie n’est rien d’autre que d’être le narrateur » (5). Bien qu’elle n’apparaisse qu’à la fin de la pièce, Madame Schuster est sur toutes les lèvres des autres personnages et hante la scène, tout comme les costumes et les valises du professeur Schuster qui devaient être envoyés à Oxford, mais qui encombrent encore l’appartement. L’état dépressif et les hallucinations auditives de Madame Schuster, qui entend depuis plus de dix ans les clameurs de la foule de la Place des Héros en 1938, posent l’événement historique et ses répercussions ainsi que leur mode d’apparition, le trauma, comme problématiques centrales de la pièce.
Même après que le procès Eichmann et celui de Francfort ont attesté de la responsabilité du pays annexé dans les crimes nazis, l’Autriche de 1988 se perçoit encore généralement comme une victime du Troisième Reich (6). La pièce provoque un débat, ou plutôt, un scandale, en ce qu’elle adopte la position inverse, doublée d’un pessimisme radical, voire outrancier. Le parti pris de Bernhard est nourri, tout comme celui de ses détracteurs est gêné, par le cas Kurt Waldheim et l’élection récente de Jörg Haider comme président du Parti de la Liberté d’Autriche (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ) (1986) (7). Place des Héros annihile toute vision ou espoir pour l’avenir de l’Autriche, ce « cloaque sans esprit ni culture » (8) où le « malheur autrichien » (9) ne semble pouvoir que tourner en boucle. L’auteur offre une image de son pays englué dans un statisme obtus et une aliénation sans appel, et, pour comble, enracine l’identité autrichienne même dans l’antisémitisme à travers les mots de Robert Schuster : « la haine du juif est la nature la plus pure absolument authentique / de l’Autrichien » (10).
Le présent est figé, tel le corps de Josef Schuster gisant sur la Place des Héros, que Herta la bonne persiste à regarder par la fenêtre, bien qu’il ait disparu. Le passé revient de manière lancinante par les mots de Josef Schuster que les personnages échangent en dialogues de sourds ou encore par la répétition en leitmotive de fragments de texte tout au long de la pièce. Autant de perturbations qui mettent en doute les notions de début et de fin, de renouveau et de deuil. Là aussi est-il possible de voir une raison supplémentaire à la polémique créée par la pièce à sa parution. Bernhard aurait touché à une corde particulièrement sensible chez la génération de l’après-guerre selon Dagmar Lorenz, soit l’angoisse de la « confrontation au passé » et des « ajustements pour le futur » (11). Bernhard qualifie son théâtre comme étant dépourvu de « saut périlleux » (12), il serait une antithèse du théâtre de péripéties. Le seul « saut » est effectivement celui de Josef Schuster, et il a lieu avant même que le rideau ne se lève. Dans cette pièce de l’après, du refus de l’événement, de tout événement, il n’est donc point question de représentation de l’acte suicidaire de Josef Schuster comme tel, pourtant il est au centre de chaque scène. Son suicide rend sensible cette cohabitation bernhardienne de la vie et de la mort et donne lieu par là à une remise en question des limites que ces dernières constituent pour l’existence ainsi que de la valeur et du sens accordés au temps. Il se pose aux côtés de la vie et de la mort comme un pôle existentiel à part entière, celui de l’esthétique, et met en lumière le caractère théâtral de la vie.
Le suicide comme posture vitale
« la vie toute entière n’est rien d’autre que la mort » (13)
Dans cette formule de Bernhard : « vie ou ce qu’on appelle ainsi » (14), le terme « ou » souligne la fragilité du concept de vie, ouvre la voie à d’autres acceptions et porte atteinte au système binaire vie/mort. L’existence serait plutôt à diviser en plusieurs possibles, des états qui portent en eux une part de vie et de mort. Robert Schuster dit de son frère qu’il pense au suicide depuis l’enfance (15), comme le peintre Strauch du roman Gel (1967), dans lequel Bernhard écrit que la « réalisation » du suicide « a lieu au moment de la naissance » (16). La mort en tant que partie intégrante de la vie serait à comprendre comme la conscience permanente d’une non-vie. En tant que non-croyants, Robert et Josef Schuster ne pensent pas la mort comme une continuation de la vie dans un monde parallèle, mais comme l’Autre radical de la vie : « Toute ma vie ça a été mon plus grand avantage / de n’avoir jamais cru en Dieu / et d’avoir toujours su / que le but c’est la fin […] votre père le pensait aussi » (17). Voilà le paradoxe par excellence qui s’élève au milieu de tous ceux qui composent les personnages bernhardiens : cet autre possible, presque salvateur, permet en quelque sorte de vivre tout en faisant de la vie une souffrance. L’existence chez Bernhard serait, dans les mots de Marc Moser, un « processus de dépérissement et la création, un épuisement » (18). La vie est ainsi faite qu’elle s’abîme sans cesse dans un frottement avec la pensée récurrente de la mort.
Plusieurs personnages de Bernhard sont en effet des créateurs du type « homme de l’esprit » (Geistesmenschen) dévoués à une activité intellectuelle au facteur d’abstraction élevé, comme l’écriture. C’est le cas de Josef Schuster qui produit une œuvre en trois volumes, Les Signes du Temps, laissée inachevée après sa mort. Les propos de Robert Schuster à ses nièces selon lesquels « le corps est fichu mais la tête chaque jour / renaît » (19) rappellent ceux de Bernhard lui-même : « Plus on vieillit, plus on trouve la vie intéressante. Lorsque le corps est usé, l’esprit se développe étonnamment bien » (20). Les frères Schuster s’inscrivent tous deux dans un refus du corps, l’un le supprime, l’autre le laisse vieillir et s’en détache par l’esprit, tant d’états, de chemins possibles, fatals ou non, qui visent à une « vie cérébrale » à travers l’« épuisement ». Au contraire, Madame Schuster a toutes les caractéristiques de la mort ou de « ce qu’on appellerait ainsi ». Elle serait victime de mort cérébrale, presque muette, immobile, « blanche » et « raide » après avoir avalé sa soupe (21), ne sortant jamais si ce n’est sur la terrasse de la maison de campagne familiale de Neuhaus, jour après jour. Les univers matériel, le corps, et immatériel, l’esprit, semblent encore moins miscibles que ceux de la vie et de la mort. Place des Héros serait le récit de l’« épuisement » de Josef Schuster distribué entre les personnages survivants dont il n’est pas si aisé de dire qu’ils sont vivants, puisque leur parole ne leur appartient pas tout à fait.
De la même manière que dans le roman Corrections (1975), où le personnage de Rothaimer qui s’est suicidé reprend vie à travers son ami le narrateur qui parcourt les livres, journaux et objets que le suicidé a laissés derrière lui, la présence de Josef Schuster se manifeste par incises dans le texte des survivants, comme ici où, à cause de l’absence d’un « disait-il » ou d’un quelconque marqueur de parole rapportée ou de ponctuation, il est difficile d’établir si l’appréciation des costumes anglais que formule Madame Zittel lui appartient ou appartient au suicidé : « Chaque année il allait en Angleterre / et s’achetait un costume / les costumes anglais / sont toujours les meilleurs » (22). Pour le lecteur, la typographie, qui diffère dans les versions allemande et française, affecte également l’attribution de la parole. Elle est également accessible au metteur en scène et aux comédiens qui ont pour tâche de la prendre ou non en considération dans leur interprétation du texte. Dans la version originale, les phrases s’apparentent à des vers, sectionnées de manière à créer un rythme poétique plus que prosaïque, un tissu de mots, une portée musicale, dont la note finale, souvent une préposition, est reportée à la ligne suivante. Cet effet n’est pas reproduit de manière systématique dans la version française, par exemple ici où Herta dit : « Tu dois ouvrir complètement les jalousies / pour qu’il entre de l’air frais » (23), alors que la version originale comporte trois lignes : « Mach die Fenster und die Jalousien im Speiszimmer / auf / jetzt kommt gute Luft herein » (24). L’impression d’uniformité ou de rythme continu du texte original est due à l’absence de signes de ponctuation, qui outrepasse même les règles de la syntaxe allemande. Le lecteur est envoûté par cette sorte de prière collective monotone qui n’est interrompue que par les didascalies qui, elles, sont en italique et comportent des signes de ponctuation. La version française adopte une autre règle typographique et inclut dans le corps du texte certains termes en italique, offrant non seulement au lecteur, mais également à l’interprète et au spectateur, un texte plus expressif, ponctué d’accents toniques plus clairement définis. À la première scène, Madame Zittel repasse et plie les chemises du défunt. Cet acte la replonge dans ses souvenirs et elle se met à raconter à Herta les manies tyranniques du professeur Schuster. Elle dit d’abord :
il pliait la chemise (…) et puis il disait maintenant c’est vous qui la pliez Madame Zittel (…) je ne pouvais pas / mes mains tremblaient tellement / que je ne pouvais pas plier la chemise / Comme ça disait le professeur comme ça / et il rabattait les manches / comme ça Madame Zittel comme ça comme ça comme ça / et il me jetait la chemise à la figure. (25)
Plus loin, elle aborde de nouveau le sujet : « Les gens riches sont tous / au cimetière de Döbling / les Schuster ont une tombe pour la durée du cimetière / C’est comme ça que le professeur voulait / que je plie ses chemises » (26). Dans le premier extrait, l’expression « disait le professeur » qui suit le « Comme ça » indique clairement que la gouvernante cite les mots de son maître. L’italique ne joue pas ici le rôle de marqueur de parole rapportée, mais imprime la perception du lecteur qui retrouve la même formulation, « comme ça », dans l’extrait suivant. Dans une phrase qui semble appartenir en totalité à son locuteur, soit « C’est comme ça que le professeur voulait / que je plie les chemises », l’italique contribue à l’insertion non pas d’un second niveau de discours, les paroles du professeur, mais d’un troisième, c’est-à-dire la voix-même du suicidé. Cette dernière martèle la conscience de la gouvernante, produisant une autre forme d’envoûtement que celle de la version originale. Le professeur Schuster tout comme sa gouvernante acquièrent un statut ambigu entre vie et mort : l’un, survivant à son suicide par le biais d’une subordonnée dont il continue de dérober la subjectivité en la rendant « étrangère » (27) à ses propres paroles ; l’autre, en tant que « souvenante », dans les mots de Jean-Pierre Sarrazac (28), faisant du pire cauchemar d’un suicidé une réalité, c’est-à-dire que sa mémoire survive à son corps et subisse encore la vie.
Dans cette formule de Bernhard : « vie ou ce qu’on appelle ainsi » (14), le terme « ou » souligne la fragilité du concept de vie, ouvre la voie à d’autres acceptions et porte atteinte au système binaire vie/mort. L’existence serait plutôt à diviser en plusieurs possibles, des états qui portent en eux une part de vie et de mort. Robert Schuster dit de son frère qu’il pense au suicide depuis l’enfance (15), comme le peintre Strauch du roman Gel (1967), dans lequel Bernhard écrit que la « réalisation » du suicide « a lieu au moment de la naissance » (16). La mort en tant que partie intégrante de la vie serait à comprendre comme la conscience permanente d’une non-vie. En tant que non-croyants, Robert et Josef Schuster ne pensent pas la mort comme une continuation de la vie dans un monde parallèle, mais comme l’Autre radical de la vie : « Toute ma vie ça a été mon plus grand avantage / de n’avoir jamais cru en Dieu / et d’avoir toujours su / que le but c’est la fin […] votre père le pensait aussi » (17). Voilà le paradoxe par excellence qui s’élève au milieu de tous ceux qui composent les personnages bernhardiens : cet autre possible, presque salvateur, permet en quelque sorte de vivre tout en faisant de la vie une souffrance. L’existence chez Bernhard serait, dans les mots de Marc Moser, un « processus de dépérissement et la création, un épuisement » (18). La vie est ainsi faite qu’elle s’abîme sans cesse dans un frottement avec la pensée récurrente de la mort.
Plusieurs personnages de Bernhard sont en effet des créateurs du type « homme de l’esprit » (Geistesmenschen) dévoués à une activité intellectuelle au facteur d’abstraction élevé, comme l’écriture. C’est le cas de Josef Schuster qui produit une œuvre en trois volumes, Les Signes du Temps, laissée inachevée après sa mort. Les propos de Robert Schuster à ses nièces selon lesquels « le corps est fichu mais la tête chaque jour / renaît » (19) rappellent ceux de Bernhard lui-même : « Plus on vieillit, plus on trouve la vie intéressante. Lorsque le corps est usé, l’esprit se développe étonnamment bien » (20). Les frères Schuster s’inscrivent tous deux dans un refus du corps, l’un le supprime, l’autre le laisse vieillir et s’en détache par l’esprit, tant d’états, de chemins possibles, fatals ou non, qui visent à une « vie cérébrale » à travers l’« épuisement ». Au contraire, Madame Schuster a toutes les caractéristiques de la mort ou de « ce qu’on appellerait ainsi ». Elle serait victime de mort cérébrale, presque muette, immobile, « blanche » et « raide » après avoir avalé sa soupe (21), ne sortant jamais si ce n’est sur la terrasse de la maison de campagne familiale de Neuhaus, jour après jour. Les univers matériel, le corps, et immatériel, l’esprit, semblent encore moins miscibles que ceux de la vie et de la mort. Place des Héros serait le récit de l’« épuisement » de Josef Schuster distribué entre les personnages survivants dont il n’est pas si aisé de dire qu’ils sont vivants, puisque leur parole ne leur appartient pas tout à fait.
De la même manière que dans le roman Corrections (1975), où le personnage de Rothaimer qui s’est suicidé reprend vie à travers son ami le narrateur qui parcourt les livres, journaux et objets que le suicidé a laissés derrière lui, la présence de Josef Schuster se manifeste par incises dans le texte des survivants, comme ici où, à cause de l’absence d’un « disait-il » ou d’un quelconque marqueur de parole rapportée ou de ponctuation, il est difficile d’établir si l’appréciation des costumes anglais que formule Madame Zittel lui appartient ou appartient au suicidé : « Chaque année il allait en Angleterre / et s’achetait un costume / les costumes anglais / sont toujours les meilleurs » (22). Pour le lecteur, la typographie, qui diffère dans les versions allemande et française, affecte également l’attribution de la parole. Elle est également accessible au metteur en scène et aux comédiens qui ont pour tâche de la prendre ou non en considération dans leur interprétation du texte. Dans la version originale, les phrases s’apparentent à des vers, sectionnées de manière à créer un rythme poétique plus que prosaïque, un tissu de mots, une portée musicale, dont la note finale, souvent une préposition, est reportée à la ligne suivante. Cet effet n’est pas reproduit de manière systématique dans la version française, par exemple ici où Herta dit : « Tu dois ouvrir complètement les jalousies / pour qu’il entre de l’air frais » (23), alors que la version originale comporte trois lignes : « Mach die Fenster und die Jalousien im Speiszimmer / auf / jetzt kommt gute Luft herein » (24). L’impression d’uniformité ou de rythme continu du texte original est due à l’absence de signes de ponctuation, qui outrepasse même les règles de la syntaxe allemande. Le lecteur est envoûté par cette sorte de prière collective monotone qui n’est interrompue que par les didascalies qui, elles, sont en italique et comportent des signes de ponctuation. La version française adopte une autre règle typographique et inclut dans le corps du texte certains termes en italique, offrant non seulement au lecteur, mais également à l’interprète et au spectateur, un texte plus expressif, ponctué d’accents toniques plus clairement définis. À la première scène, Madame Zittel repasse et plie les chemises du défunt. Cet acte la replonge dans ses souvenirs et elle se met à raconter à Herta les manies tyranniques du professeur Schuster. Elle dit d’abord :
il pliait la chemise (…) et puis il disait maintenant c’est vous qui la pliez Madame Zittel (…) je ne pouvais pas / mes mains tremblaient tellement / que je ne pouvais pas plier la chemise / Comme ça disait le professeur comme ça / et il rabattait les manches / comme ça Madame Zittel comme ça comme ça comme ça / et il me jetait la chemise à la figure. (25)
Plus loin, elle aborde de nouveau le sujet : « Les gens riches sont tous / au cimetière de Döbling / les Schuster ont une tombe pour la durée du cimetière / C’est comme ça que le professeur voulait / que je plie ses chemises » (26). Dans le premier extrait, l’expression « disait le professeur » qui suit le « Comme ça » indique clairement que la gouvernante cite les mots de son maître. L’italique ne joue pas ici le rôle de marqueur de parole rapportée, mais imprime la perception du lecteur qui retrouve la même formulation, « comme ça », dans l’extrait suivant. Dans une phrase qui semble appartenir en totalité à son locuteur, soit « C’est comme ça que le professeur voulait / que je plie les chemises », l’italique contribue à l’insertion non pas d’un second niveau de discours, les paroles du professeur, mais d’un troisième, c’est-à-dire la voix-même du suicidé. Cette dernière martèle la conscience de la gouvernante, produisant une autre forme d’envoûtement que celle de la version originale. Le professeur Schuster tout comme sa gouvernante acquièrent un statut ambigu entre vie et mort : l’un, survivant à son suicide par le biais d’une subordonnée dont il continue de dérober la subjectivité en la rendant « étrangère » (27) à ses propres paroles ; l’autre, en tant que « souvenante », dans les mots de Jean-Pierre Sarrazac (28), faisant du pire cauchemar d’un suicidé une réalité, c’est-à-dire que sa mémoire survive à son corps et subisse encore la vie.
Contretemps, contresens
« Tout point final annule tout ce qui a précédé, et là on peut tout reprendre au début, si du moins on sait où est le début et où est la fin. » (29)
Le suicide dans Place des Héros, cette interruption du cours dit « naturel » de la vie par la mort, ce rapprochement forcé par la volonté de l’homme du début et de la fin, relativise le temps accordé aux ambitions humaines et la valeur qui en découle. Alors que Les Signes du Temps, auquel Josef Schuster voue plusieurs années de son existence, devrait donner un sens à sa vie, le suicide du professeur en marque l’insignifiance, comme son frère le note : « Efforts perpétuels / et toujours tout poussé vers les hauteurs les plus hautes / et à la fin totale inanité » (30). Le suicide de Josef Schuster révèle que la mesure que prend l’individu des limites de son pouvoir, celui de faire œuvre tout comme celui de faire exception à la bêtise générale de la « masse » (31), est dérisoire. La vie n’est pas à la mesure des ambitions de l’homme et vice versa. Tel est l’écart éternel qui pousse le professeur au suicide, comme l’explique Bernhard au sujet de Glenn Gould dans Le Naufragé : « Notre existence consiste à être continuellement contre la nature et à procéder contre la nature, disait Glenn, à procéder contre la nature jusqu’au moment où nous baissons les bras parce que la nature est plus forte que nous » (32). Alors que Robert Schuster dit de son frère qu’il portait le suicide en lui depuis son enfance, Madame Zittel affirme que « le suicide est toujours un coup de tête » (33). Ces avis contraires proposent une conception irrationnelle du temps où la vie et la durée qui lui est consacrée n’ont pas plus de valeur que la mort, dans les mots d’Erika Tunner : « jamais, en aucune occurrence ni en rien, il n’existe de moment idéal » (34). L’individu serait plutôt confronté à un temps dont le poids varie sur l’affect d’instant en instant, s’accumule et se dissout sans logique apparente.
Robert Schuster reprend les propos de son frère au sujet de son livre : « tout n’est plus qu’un immense dépôt de bilan / à la fin je me suis trompé dans mes calculs / probablement trompé dans ma propre folie des grandeurs a-t-il dit / je ne comprends plus les signes du temps / les signes du temps personne ne les comprend » (35). Avec le terme « temps », il souligne à la fois cette suppression des attentes et des espoirs liés à la durée de la vie, mais également le désenchantement par rapport à son époque. Si le livre de Josef Schuster, selon son frère, a perdu son sens après sa mort, s’il n’est devenu « que fragment / des monceaux de fiches rien d’autre » (36), ce n’est qu’au regard d’une certaine forme de vie. Fragmentaire, l’écriture de Bernhard l’est aussi, empêchant le sens de se clore, la vérité de tomber et donc la mort d’advenir, dans un esprit nietzschéen. Des segments de phrase sans ponctuation obéissent au mouvement d’un souffle court : « Je me souviens qu’un jour votre père a dit / Je vais dans la Mariahilferstrasse / et cherche la Mariahilferstrasse / et je suis dans la Mariahilferstrasse / et ne la trouve pas » (37). Si cet « épuisement » qu’est la création est vain, si, selon Robert Schuster, la réalité « ne peut pas être décrite », la raison en est qu’elle est « abominable » (38), mais tout autant qu’il est impossible de l’enserrer par l’écriture. Avec les mots de Robert Schuster, Bernhard court-circuite sa propre pratique dans une sorte de mise en abyme et raffermit sa position selon laquelle l’écriture ne doit pas viser à la vérité. L’expression forgée par Jens Dittmar, les « mots-attentats » (Wortattentate) (39), renvoie aux attaques en bonne et due forme envers l’Autriche qui constituent le discours de Robert Schuster ainsi qu’aux armes servant à l’inachèvement du sens. C’est dans l’obscurité et la négativité que l’auteur « s’épuise » plus que dans la clarté d’un discours positif, positiviste. Puisque la parole directe n’est pas garante de vérité, le mode citationnel et la contradiction sont employés pour satisfaire la nécessaire médiation de la parole, pour instaurer un flou au bénéfice d’une clarté. Ainsi Madame Zittel cite-t-elle le professeur tantôt louant l’Angleterre (40), tantôt pestant contre elle (41), ou encore clôt un discours que tient le professeur contre les gens qui n’aiment pas Sarasate ou Glenn Gould avec l’affirmation « je n’aime pas du tout le piano » (42), laissant planer une confusion quant à qui, de Madame Zittel, de Madame Schuster, voire du professeur lui-même, appartiennent ces mots.
La citation et la contradiction sont une manière d’art. En tant que déviations, elles permettent d’atteindre à une forme d’authenticité. Cette authenticité apparaît seulement si l’illusion d’un contact immédiat avec le réel est détruite par une mise à distance, Bernhard soutient en ce sens que : « si nous nous lançons sur les traces de la vérité, sans savoir ce qu’est cette vérité, qui n’a en commun avec la réalité que la vérité que nous ignorons, c’est au fond l’échec, la mort dont nous suivons la trace » (43). Il s’agit pour Bernhard, comme pour Josef Schuster, de laisser le sens et l’œuvre inachevés pour ne pas prononcer la sentence finale et déjouer l’ordre établi entre naissance et mort. Le suicide de Josef Schuster et le système d’écriture bernhardien n’entrent pas en contradiction avec une dynamique existentielle de vie. Symboliquement, ils représentent cette « rupture » que l’auteur est sujet à commettre selon Bernhard : « Et rien de plus faux que d’écrire un livre jusqu’au bout. C’est la faute la plus grave que puisse commettre un auteur. De même dans les rapports avec autrui, mieux vaut rompre brusquement » (44). Cette rupture renvoie également à un refus de s’inscrire dans la culture, survivance de l’ambition des hommes, mortifère tout autant que salvatrice, suivant ce que rapporte Robert Schuster au sujet de la littérature : « Mon frère a fui lui aussi ces gens effroyables / dans Kleist Goethe Kafka » (45) et de la musique : « il ne pouvait entendre la musique / qu’après s’être forcé à ne plus entendre / la mentalité national-socialiste des auditeurs du Musikverein » (46).
Le suicide dans Place des Héros, cette interruption du cours dit « naturel » de la vie par la mort, ce rapprochement forcé par la volonté de l’homme du début et de la fin, relativise le temps accordé aux ambitions humaines et la valeur qui en découle. Alors que Les Signes du Temps, auquel Josef Schuster voue plusieurs années de son existence, devrait donner un sens à sa vie, le suicide du professeur en marque l’insignifiance, comme son frère le note : « Efforts perpétuels / et toujours tout poussé vers les hauteurs les plus hautes / et à la fin totale inanité » (30). Le suicide de Josef Schuster révèle que la mesure que prend l’individu des limites de son pouvoir, celui de faire œuvre tout comme celui de faire exception à la bêtise générale de la « masse » (31), est dérisoire. La vie n’est pas à la mesure des ambitions de l’homme et vice versa. Tel est l’écart éternel qui pousse le professeur au suicide, comme l’explique Bernhard au sujet de Glenn Gould dans Le Naufragé : « Notre existence consiste à être continuellement contre la nature et à procéder contre la nature, disait Glenn, à procéder contre la nature jusqu’au moment où nous baissons les bras parce que la nature est plus forte que nous » (32). Alors que Robert Schuster dit de son frère qu’il portait le suicide en lui depuis son enfance, Madame Zittel affirme que « le suicide est toujours un coup de tête » (33). Ces avis contraires proposent une conception irrationnelle du temps où la vie et la durée qui lui est consacrée n’ont pas plus de valeur que la mort, dans les mots d’Erika Tunner : « jamais, en aucune occurrence ni en rien, il n’existe de moment idéal » (34). L’individu serait plutôt confronté à un temps dont le poids varie sur l’affect d’instant en instant, s’accumule et se dissout sans logique apparente.
Robert Schuster reprend les propos de son frère au sujet de son livre : « tout n’est plus qu’un immense dépôt de bilan / à la fin je me suis trompé dans mes calculs / probablement trompé dans ma propre folie des grandeurs a-t-il dit / je ne comprends plus les signes du temps / les signes du temps personne ne les comprend » (35). Avec le terme « temps », il souligne à la fois cette suppression des attentes et des espoirs liés à la durée de la vie, mais également le désenchantement par rapport à son époque. Si le livre de Josef Schuster, selon son frère, a perdu son sens après sa mort, s’il n’est devenu « que fragment / des monceaux de fiches rien d’autre » (36), ce n’est qu’au regard d’une certaine forme de vie. Fragmentaire, l’écriture de Bernhard l’est aussi, empêchant le sens de se clore, la vérité de tomber et donc la mort d’advenir, dans un esprit nietzschéen. Des segments de phrase sans ponctuation obéissent au mouvement d’un souffle court : « Je me souviens qu’un jour votre père a dit / Je vais dans la Mariahilferstrasse / et cherche la Mariahilferstrasse / et je suis dans la Mariahilferstrasse / et ne la trouve pas » (37). Si cet « épuisement » qu’est la création est vain, si, selon Robert Schuster, la réalité « ne peut pas être décrite », la raison en est qu’elle est « abominable » (38), mais tout autant qu’il est impossible de l’enserrer par l’écriture. Avec les mots de Robert Schuster, Bernhard court-circuite sa propre pratique dans une sorte de mise en abyme et raffermit sa position selon laquelle l’écriture ne doit pas viser à la vérité. L’expression forgée par Jens Dittmar, les « mots-attentats » (Wortattentate) (39), renvoie aux attaques en bonne et due forme envers l’Autriche qui constituent le discours de Robert Schuster ainsi qu’aux armes servant à l’inachèvement du sens. C’est dans l’obscurité et la négativité que l’auteur « s’épuise » plus que dans la clarté d’un discours positif, positiviste. Puisque la parole directe n’est pas garante de vérité, le mode citationnel et la contradiction sont employés pour satisfaire la nécessaire médiation de la parole, pour instaurer un flou au bénéfice d’une clarté. Ainsi Madame Zittel cite-t-elle le professeur tantôt louant l’Angleterre (40), tantôt pestant contre elle (41), ou encore clôt un discours que tient le professeur contre les gens qui n’aiment pas Sarasate ou Glenn Gould avec l’affirmation « je n’aime pas du tout le piano » (42), laissant planer une confusion quant à qui, de Madame Zittel, de Madame Schuster, voire du professeur lui-même, appartiennent ces mots.
La citation et la contradiction sont une manière d’art. En tant que déviations, elles permettent d’atteindre à une forme d’authenticité. Cette authenticité apparaît seulement si l’illusion d’un contact immédiat avec le réel est détruite par une mise à distance, Bernhard soutient en ce sens que : « si nous nous lançons sur les traces de la vérité, sans savoir ce qu’est cette vérité, qui n’a en commun avec la réalité que la vérité que nous ignorons, c’est au fond l’échec, la mort dont nous suivons la trace » (43). Il s’agit pour Bernhard, comme pour Josef Schuster, de laisser le sens et l’œuvre inachevés pour ne pas prononcer la sentence finale et déjouer l’ordre établi entre naissance et mort. Le suicide de Josef Schuster et le système d’écriture bernhardien n’entrent pas en contradiction avec une dynamique existentielle de vie. Symboliquement, ils représentent cette « rupture » que l’auteur est sujet à commettre selon Bernhard : « Et rien de plus faux que d’écrire un livre jusqu’au bout. C’est la faute la plus grave que puisse commettre un auteur. De même dans les rapports avec autrui, mieux vaut rompre brusquement » (44). Cette rupture renvoie également à un refus de s’inscrire dans la culture, survivance de l’ambition des hommes, mortifère tout autant que salvatrice, suivant ce que rapporte Robert Schuster au sujet de la littérature : « Mon frère a fui lui aussi ces gens effroyables / dans Kleist Goethe Kafka » (45) et de la musique : « il ne pouvait entendre la musique / qu’après s’être forcé à ne plus entendre / la mentalité national-socialiste des auditeurs du Musikverein » (46).
Le suicide comme posture esthétique
« le bien le plus précieux de l’homme est de se soustraire au monde par la libre décision, […] de préférence d’une façon esthétique » (47)
Cette relation d’amour et de haine par rapport à la culture et à l’Autriche en général, ce que Robert Schuster nomme le « piège de l’Autriche », qui séduit et « révulse » (48) à la fois, est caractéristique de la position d’artiste-observateur des frères Schuster, et par extension de Bernhard. L’artiste-observateur et le suicidé connaissent la mort chacun à leur manière en s’excluant du monde. Dans la nouvelle Tonio Kröger (1903) de Thomas Mann, le protagoniste qui veut devenir poète s’extirpe du flot de la vie en ne prenant pas part à un cours de danse qui se déroule devant ses yeux ; une scène qui suggère que l’expérience esthétique de la vie implique un renoncement douloureux : « le sentiment, le sentiment vivant et chaud est toujours banal, inutilisable, et seules les vibrations, les froides extases de notre système nerveux corrompu, de notre système nerveux d’artiste ont un caractère esthétique » (49). L’artiste-observateur renie toute vérité au langage comme le suicidé perd foi dans le monde, les deux passent dans ce que Bernhard appelle les « ténèbres définitives » :
C’est l’identification avec ces choses qui sont formées de phrases, et l’on ne sait rien ni des choses ni des phrases, et l’on ne sait jamais rien du tout. Voilà le quotidien par rapport auquel il faut prendre ses distances. Il faudrait sortir de tout, non pas fermer la porte derrière soi, mais la claquer d’un coup et partir. (…) Il faudrait sortir de ces ténèbres qu’il est impossible, qu’il est devenu en fin de compte totalement impossible de maîtriser sa vie durant, et entrer dans ces autres, ces secondes, ces définitives ténèbres que l’on a devant soi et pouvoir les atteindre aussi vite que possible, sans détours, sans arguties philosophiques, y entrer tout simplement… et si possible précipiter l’arrivée des ténèbres en fermant les yeux et ne les rouvrir que quand on aurait la certitude d’être absolument dans les ténèbres, les ténèbres définitives. (50)
L’origine de l’inadéquation entre Josef Schuster et le monde qui le pousse aux « ténèbres définitives » n’est pas clairement déterminée dans la pièce. La société autrichienne le persécute, il raconte une série d’actes antisémites, notamment que des gens à Vienne ont « craché » sur sa fille (51), mais Robert Schuster dit aussi de lui et de sa femme qu’ils souffrent du « délire de la persécution » (52), phénomène que le point d’interrogation final dans le titre du poème de Bernhard, « Manie de la persécution ? » (1982), contribue à discréditer. Cette désolation devant l’incompréhension de la capacité du monde à contenir autant de bêtise couplée à une acceptation ferme qu’il n’y a rien à y comprendre poussent à l’auto-exclusion, dans le suicide, pour Josef Schuster ; dans le délire, pour Madame Schuster ; ou dans l’observation passive, pour Robert Schuster, qui dit à ses nièces : « Je ne me mêle plus de rien / ma vie est en fait plus ou moins achevée […] qu’ils fassent tous ce qu’ils veulent / je ne proteste plus contre rien / ça ne veut d’ailleurs pas dire que je ne sois pas contre / je suis en fait contre presque tout » (53).
Qu’il soit du ressort de Josef Schuster ou de la société qui l’entoure, cet isolement mine graduellement les refuges de l’artiste-observateur : il lui est de plus en plus difficile d’aller au Musikverein, il ne comprend plus son propre livre, il ne peut vivre ni à Vienne qui lui est « inhumain »(54), ni à Neuhaus qui ne lui est « supportable que quelques heures » (55), ni à Oxford où il ne pourrait plus manger les gâteaux à la crème du pâtissier Handlos (56), même si, de toute façon, comme le rappelle Robert Schuster : « ce n’est pas parce qu’une fois vous mangez bien dans une auberge / ou buvez dans un café un bon café / que vous avez le droit d’oublier / que vous vous trouvez dans celui de tous les États européens qui est le plus grand danger public » (57). Cette permanente mise à distance du monde est une lutte en soi. Ainsi, bien que Robert Schuster dise avoir renoncé à toute protestation, il se trouve lui aussi dans un état d’exténuation, toute la seconde scène étant d’ailleurs composée en majorité d’un long monologue de sa part, lui qui peine à se lever de son banc et à marcher dans le Volksgarten. Pour le metteur en scène Krystian Lupa, les longs monologues chez Bernhard seraient une autre manière d’atteindre à une forme d’authenticité, hors du langage, peut-être même de pénétrer les « ténèbres définitives », une forme d’existence autre que celle limitée par la vie et la mort : « un nouveau sens se dégage de toute cette logorrhée, un autre discours, plus consistant, plus distinct, comme si le rythme de ces flots incessants de parole donnait naissance à un nouveau format de la parole » (58). Les monologues ainsi que les répétitions, à l’échelle d’une réplique ou de toute la pièce, traduisent également une forme de panique, comme si le locuteur se trouvait entraîné dans une spirale le menant à la folie. Pour les frères Schuster, les lieux, les paysages, puis les mots deviennent de moins en moins habitables. L’insistance de Robert Schuster sur le terme « tout » rend palpable cette totale annihilation que traverse l’Autriche à ses yeux : « car partout tout est anéanti / partout la nature est anéantie / la nature et l’architecture tout » (59), « tout est à l’agonie où qu’on regarde / tout est à l’abandon où qu’on regarde » (60), ou encore celle de Josef Schuster, cité par Madame Zittel : « ces gens-là démolissent toujours tout et tous » (61).
La folie est une proche voisine de la mort ou du suicide pour Josef Schuster qui se confie à Madame Zittel au sujet des hallucinations de sa femme : « c’est à devenir fou à devenir fou Madame Zittel / et j’en deviendrai fou deviendrai fou » (62). Il parle peu après de Steinhof, un hôpital psychiatrique de Vienne, où sa femme a reçu un électrochoc. Steinhof est connu pour sa fréquentation par la haute société viennoise et, plus tristement, pour les euthanasies qui y ont été pratiquées sous le national-socialisme. Ce lieu renvoie à la marginalisation qui s’opère dans les sphères politique et intime de la vie des Schuster : ils y ont trouvé refuge avant d’émigrer en Angleterre à l’avènement du national-socialisme et y reçoivent des soins psychologiques depuis des générations. Il marque également leur appartenance à la « bonne société viennoise » (63) que Robert Schuster décrit comme un fardeau : « héritage grand-bourgeois / ça nous a pesé toute la vie » (64). Il est ainsi un espace à la fois de la persécution et de la construction de l’identité, révélateur du mal de l’esprit des Schuster qui vient à ronger leur corps. Certaines répliques laissent entendre que cette maladie est une tare familiale, culturelle, nationale, Madame Zittel affirmant que : « Le Pavillon Friedrich est pour les gens bien qui sont déprimés / ils ne sont pas vraiment malades et pourtant si » (65), ou encore, parlant de la maladie de Robert Schuster : « Le professeur en fait manque d’air / même à l’arrêt / mais quelquefois il n’a aucune difficulté / il paraît que tout ça est aussi psychique » (66). L’idée de Thorsten Themann selon laquelle les personnages bernhardiens atteignent grotesquement à travers la psychose une plus grande valeur sensible et intellectuelle (67) est en adéquation avec le fait que Steinhof soit pour plusieurs membres de la lignée des Schuster le « terminus » (68). Les troubles psychologiques menant à la mort ou au suicide s’avèrent être une autre porte vers les « ténèbres définitives » et l’esthétisation de l’existence. Bernhard lui-même transforme la mort en « une construction artistique qui permettra de vivre » (69) durant ses séjours au sanatorium.
Le suicide est conçu dans l’œuvre de Bernhard comme un geste éminemment théâtral. Il se tient dans un fragile équilibre entre réalité et fiction ou idéal. Les propos de Bernhard conduisent à penser que le suicide devient « horrible » lorsqu’il prend l’épaisseur du réel et devient spectacle, lorsqu’il est tenu à distance dans le monde de l’art, même au cœur de l’existence :
La plupart (de mes ascendants) se sont brusquement suicidés (…). De me souvenir de ces gens-là me semble à la fois horrible et agréable. Y penser me met dans un état de spectateur, au théâtre, au lever du rideau, lorsque l’on départage les gens en bons et en mauvais, non seulement en bons et en mauvais personnages, hommes et personnalités, mais aussi en bons et en mauvais comédiens. Et je dois dire que c’est un vrai plaisir que d’assister, de temps à autre, une fois encore à cette représentation. (70)
La pièce de Bernhard est empreinte de l’idée que celui qui sublime son mal-être n’en ressort pas victime, tel Josef Schuster qui est approuvé par son frère ; contrairement à celui qui mène une vie non-esthétique, telle Madame Schuster. Dans cette perspective, Robert Schuster affirme : « Sur cette femme pèse aussi une malédiction / Si seulement c’était un personnage littéraire / mais c’est un personnage réel / ai-je toujours dit à votre père / voilà le malheur » (71). Il y a mise en abyme dans le fait qu’un personnage littéraire, Robert Schuster, dise d’un autre personnage littéraire qu’il n’en est pas un. Seulement, cette mise en abyme est laissée imparfaite, car elle ne permet pas de sortir entièrement du monde fictif de la pièce pour se retrouver dans la réalité de sa lecture ou de sa mise en scène. L’opposé absolu d’un « personnage littéraire » aurait été une personne ou un être réel, mais l’expression « personnage réel » qu’emploie Robert Schuster suggère que Madame Schuster, bien qu’elle soit « réelle », reste « personnage ». Elle devient un individu entre fiction et réalité, un archétype.
Cette relation d’amour et de haine par rapport à la culture et à l’Autriche en général, ce que Robert Schuster nomme le « piège de l’Autriche », qui séduit et « révulse » (48) à la fois, est caractéristique de la position d’artiste-observateur des frères Schuster, et par extension de Bernhard. L’artiste-observateur et le suicidé connaissent la mort chacun à leur manière en s’excluant du monde. Dans la nouvelle Tonio Kröger (1903) de Thomas Mann, le protagoniste qui veut devenir poète s’extirpe du flot de la vie en ne prenant pas part à un cours de danse qui se déroule devant ses yeux ; une scène qui suggère que l’expérience esthétique de la vie implique un renoncement douloureux : « le sentiment, le sentiment vivant et chaud est toujours banal, inutilisable, et seules les vibrations, les froides extases de notre système nerveux corrompu, de notre système nerveux d’artiste ont un caractère esthétique » (49). L’artiste-observateur renie toute vérité au langage comme le suicidé perd foi dans le monde, les deux passent dans ce que Bernhard appelle les « ténèbres définitives » :
C’est l’identification avec ces choses qui sont formées de phrases, et l’on ne sait rien ni des choses ni des phrases, et l’on ne sait jamais rien du tout. Voilà le quotidien par rapport auquel il faut prendre ses distances. Il faudrait sortir de tout, non pas fermer la porte derrière soi, mais la claquer d’un coup et partir. (…) Il faudrait sortir de ces ténèbres qu’il est impossible, qu’il est devenu en fin de compte totalement impossible de maîtriser sa vie durant, et entrer dans ces autres, ces secondes, ces définitives ténèbres que l’on a devant soi et pouvoir les atteindre aussi vite que possible, sans détours, sans arguties philosophiques, y entrer tout simplement… et si possible précipiter l’arrivée des ténèbres en fermant les yeux et ne les rouvrir que quand on aurait la certitude d’être absolument dans les ténèbres, les ténèbres définitives. (50)
L’origine de l’inadéquation entre Josef Schuster et le monde qui le pousse aux « ténèbres définitives » n’est pas clairement déterminée dans la pièce. La société autrichienne le persécute, il raconte une série d’actes antisémites, notamment que des gens à Vienne ont « craché » sur sa fille (51), mais Robert Schuster dit aussi de lui et de sa femme qu’ils souffrent du « délire de la persécution » (52), phénomène que le point d’interrogation final dans le titre du poème de Bernhard, « Manie de la persécution ? » (1982), contribue à discréditer. Cette désolation devant l’incompréhension de la capacité du monde à contenir autant de bêtise couplée à une acceptation ferme qu’il n’y a rien à y comprendre poussent à l’auto-exclusion, dans le suicide, pour Josef Schuster ; dans le délire, pour Madame Schuster ; ou dans l’observation passive, pour Robert Schuster, qui dit à ses nièces : « Je ne me mêle plus de rien / ma vie est en fait plus ou moins achevée […] qu’ils fassent tous ce qu’ils veulent / je ne proteste plus contre rien / ça ne veut d’ailleurs pas dire que je ne sois pas contre / je suis en fait contre presque tout » (53).
Qu’il soit du ressort de Josef Schuster ou de la société qui l’entoure, cet isolement mine graduellement les refuges de l’artiste-observateur : il lui est de plus en plus difficile d’aller au Musikverein, il ne comprend plus son propre livre, il ne peut vivre ni à Vienne qui lui est « inhumain »(54), ni à Neuhaus qui ne lui est « supportable que quelques heures » (55), ni à Oxford où il ne pourrait plus manger les gâteaux à la crème du pâtissier Handlos (56), même si, de toute façon, comme le rappelle Robert Schuster : « ce n’est pas parce qu’une fois vous mangez bien dans une auberge / ou buvez dans un café un bon café / que vous avez le droit d’oublier / que vous vous trouvez dans celui de tous les États européens qui est le plus grand danger public » (57). Cette permanente mise à distance du monde est une lutte en soi. Ainsi, bien que Robert Schuster dise avoir renoncé à toute protestation, il se trouve lui aussi dans un état d’exténuation, toute la seconde scène étant d’ailleurs composée en majorité d’un long monologue de sa part, lui qui peine à se lever de son banc et à marcher dans le Volksgarten. Pour le metteur en scène Krystian Lupa, les longs monologues chez Bernhard seraient une autre manière d’atteindre à une forme d’authenticité, hors du langage, peut-être même de pénétrer les « ténèbres définitives », une forme d’existence autre que celle limitée par la vie et la mort : « un nouveau sens se dégage de toute cette logorrhée, un autre discours, plus consistant, plus distinct, comme si le rythme de ces flots incessants de parole donnait naissance à un nouveau format de la parole » (58). Les monologues ainsi que les répétitions, à l’échelle d’une réplique ou de toute la pièce, traduisent également une forme de panique, comme si le locuteur se trouvait entraîné dans une spirale le menant à la folie. Pour les frères Schuster, les lieux, les paysages, puis les mots deviennent de moins en moins habitables. L’insistance de Robert Schuster sur le terme « tout » rend palpable cette totale annihilation que traverse l’Autriche à ses yeux : « car partout tout est anéanti / partout la nature est anéantie / la nature et l’architecture tout » (59), « tout est à l’agonie où qu’on regarde / tout est à l’abandon où qu’on regarde » (60), ou encore celle de Josef Schuster, cité par Madame Zittel : « ces gens-là démolissent toujours tout et tous » (61).
La folie est une proche voisine de la mort ou du suicide pour Josef Schuster qui se confie à Madame Zittel au sujet des hallucinations de sa femme : « c’est à devenir fou à devenir fou Madame Zittel / et j’en deviendrai fou deviendrai fou » (62). Il parle peu après de Steinhof, un hôpital psychiatrique de Vienne, où sa femme a reçu un électrochoc. Steinhof est connu pour sa fréquentation par la haute société viennoise et, plus tristement, pour les euthanasies qui y ont été pratiquées sous le national-socialisme. Ce lieu renvoie à la marginalisation qui s’opère dans les sphères politique et intime de la vie des Schuster : ils y ont trouvé refuge avant d’émigrer en Angleterre à l’avènement du national-socialisme et y reçoivent des soins psychologiques depuis des générations. Il marque également leur appartenance à la « bonne société viennoise » (63) que Robert Schuster décrit comme un fardeau : « héritage grand-bourgeois / ça nous a pesé toute la vie » (64). Il est ainsi un espace à la fois de la persécution et de la construction de l’identité, révélateur du mal de l’esprit des Schuster qui vient à ronger leur corps. Certaines répliques laissent entendre que cette maladie est une tare familiale, culturelle, nationale, Madame Zittel affirmant que : « Le Pavillon Friedrich est pour les gens bien qui sont déprimés / ils ne sont pas vraiment malades et pourtant si » (65), ou encore, parlant de la maladie de Robert Schuster : « Le professeur en fait manque d’air / même à l’arrêt / mais quelquefois il n’a aucune difficulté / il paraît que tout ça est aussi psychique » (66). L’idée de Thorsten Themann selon laquelle les personnages bernhardiens atteignent grotesquement à travers la psychose une plus grande valeur sensible et intellectuelle (67) est en adéquation avec le fait que Steinhof soit pour plusieurs membres de la lignée des Schuster le « terminus » (68). Les troubles psychologiques menant à la mort ou au suicide s’avèrent être une autre porte vers les « ténèbres définitives » et l’esthétisation de l’existence. Bernhard lui-même transforme la mort en « une construction artistique qui permettra de vivre » (69) durant ses séjours au sanatorium.
Le suicide est conçu dans l’œuvre de Bernhard comme un geste éminemment théâtral. Il se tient dans un fragile équilibre entre réalité et fiction ou idéal. Les propos de Bernhard conduisent à penser que le suicide devient « horrible » lorsqu’il prend l’épaisseur du réel et devient spectacle, lorsqu’il est tenu à distance dans le monde de l’art, même au cœur de l’existence :
La plupart (de mes ascendants) se sont brusquement suicidés (…). De me souvenir de ces gens-là me semble à la fois horrible et agréable. Y penser me met dans un état de spectateur, au théâtre, au lever du rideau, lorsque l’on départage les gens en bons et en mauvais, non seulement en bons et en mauvais personnages, hommes et personnalités, mais aussi en bons et en mauvais comédiens. Et je dois dire que c’est un vrai plaisir que d’assister, de temps à autre, une fois encore à cette représentation. (70)
La pièce de Bernhard est empreinte de l’idée que celui qui sublime son mal-être n’en ressort pas victime, tel Josef Schuster qui est approuvé par son frère ; contrairement à celui qui mène une vie non-esthétique, telle Madame Schuster. Dans cette perspective, Robert Schuster affirme : « Sur cette femme pèse aussi une malédiction / Si seulement c’était un personnage littéraire / mais c’est un personnage réel / ai-je toujours dit à votre père / voilà le malheur » (71). Il y a mise en abyme dans le fait qu’un personnage littéraire, Robert Schuster, dise d’un autre personnage littéraire qu’il n’en est pas un. Seulement, cette mise en abyme est laissée imparfaite, car elle ne permet pas de sortir entièrement du monde fictif de la pièce pour se retrouver dans la réalité de sa lecture ou de sa mise en scène. L’opposé absolu d’un « personnage littéraire » aurait été une personne ou un être réel, mais l’expression « personnage réel » qu’emploie Robert Schuster suggère que Madame Schuster, bien qu’elle soit « réelle », reste « personnage ». Elle devient un individu entre fiction et réalité, un archétype.
Désillusions théâtrales
« Où que l’on regarde, on ne voit qu’une conformation intégrale de montagnes et de flux de contemplations surfacielles théâtrales en pleine agonie. » (72)
L’artiste-observateur se détache de la réalité pour y voir plus clair – une opération antinomique avec le théâtre en tant qu’art mimétique. Pour atteindre à une forme d’authenticité, il faut s’extraire du monde, « chercher hors de la chaîne du temps » (73), voilà pourquoi Josef Schuster préfère la musique en tant qu’art immatériel au théâtre, qui est associé à la fausseté. L’authenticité des crises de Madame Schuster est mise en doute (74), peut-être parce qu’elle s’est occupé de ses usines à défaut de son intellect (75), ce qui lui vaut un caractère terrestre incapable d’abstraction. En disant que « celui qui a une fois flairé le sang au théâtre / ne peut plus exister sans théâtre » (76), Josef Schuster cité par Madame Zittel évoque la dérive de l’esprit dans la bassesse et le ridicule de l’art mimétique à laquelle obéissent notamment les institutions comme le gouvernement et l’Église qui sont associées au théâtre. La même connotation négative est attribuée à l’enterrement du professeur – un « théâtre de la mort » « pompeux », « repoussant », « niais » –, et à la Niederreiter, une comédienne que fréquente le fils de Josef Schuster, Lukas, au grand désespoir de son oncle (77). Tout à Vienne, qui n’est plus une ville de l’esprit depuis la guerre, est décrit comme « artificiellement gonflé et vulgaire » (78) par Robert Schuster. En les balayant du regard, il mêle indistinctement dans la même triste comédie les lieux de représentation que sont le Burgtheater et le Parlement, décor de la seconde scène. La vue du Parlement qui entraîne Robert Schuster à comparer la politique à une « comédie » (79) nourrit son idée selon laquelle l’Autriche de 1988 est toujours nazie. Plus tôt, il évoque également ce qui pourrait être la quintessence théâtrale de l’histoire autrichienne, soit l’Autriche nazie, en parlant d’un « metteur en scène », qui n’est pas sans rappeler Hitler, pour les « figurants » que sont le peuple autrichien (80). Le seul théâtre perçu positivement est celui de l’innocence, dépourvu d’« affectation » (81), le « vrai théâtre » (82) dans lequel jouaient les frères Schuster dans leur prime jeunesse. L’enfance acquiert de la valeur parce qu’elle est située dans le passé. Les « paysages » de « l’enfance perdue » (83) sont un espace clos et inaccessible à l’expérience immédiate, si ce n’est celle de la nostalgie, celle que Bernhard lui-même éprouve en évoquant ses racines.
Le caractère vivant du théâtre de l’innocence qui ne peut s’actualiser dans le réel entre en contraste avec le statisme du théâtre bourgeois qui jouit, inversement, d’une grande représentativité. La musique que Josef Schuster persiste à écouter permet de sortir de la réalité, alors que le mimétisme du théâtre condamne à répéter ce qui est déjà advenu, comme si le monde n’était fait que de modèles et d’imitateurs et jamais de vie véritablement vécue, comme peut le suggérer d’autre part le mode citationnel de la pièce. Chez Bernhard, la haute culture qui obéit à ce cycle conservateur et réactionnaire de la tradition et de la sacralisation subit d’ailleurs, dans les mots de Tim Reuter, une forme de « carnavalisation » (84). L’un de ses représentants est le théâtre allemand : Lukas Schuster qualifie tour à tour Minna von Barnhelm et Nathan le Sage de Lessing d’« insipide », de « théâtre de divertissement », de « risible » et de « pathétique mensonger » (85). Le terme d’« opérette », employé par Bernhard dans un article intitulé « Salzbourg attend une pièce de théâtre » (1955) – une véhémente critique du manque de renouvellement de la programmation du théâtre de Salzbourg –, sert à dénigrer le théâtre tant au Burgtheater qu’à Josefstadt, que Madame Schuster a l’habitude de fréquenter.
L’une des voies possibles pour échapper au cycle « digestif » du théâtre, dans les termes d’Anna Schuster en écho à Artaud (86), serait d’éviter un théâtre d’identification en tentant de couper les liens entre les mots et le réel. Se terrer dans l’Autre, la négation de soi, le pessimisme, le suicide reviendrait à se terrer dans la non-représentativité : un théâtre sans « saut » donc, mais surtout, sans psychologisation trop élaborée des personnages. Plurivoques mais distincts les uns des autres, les personnages de la pièce, en particulier les frères Schuster, font preuve d’une telle exagération qu’ils sont aisément discrédités, comme le rappelle Thorsten Themann (87). Bien que Josef Schuster soit misanthrope, son suicide a une portée collective, sans être pour autant revendicateur. Si la critique du théâtre dans la pièce renvoie à une critique de l’immobilisme autrichien, les notions d’héritage et d’attachement au passé ne sont pas pour autant rejetées en bloc. Le dégoût qu’éprouvent les Schuster provient par ailleurs du fait qu’à leurs yeux l’Autriche contemporaine n’est pas digne de son héritage. Cette conscience historique va de pair avec la question de l’appartenance à un groupe et à une histoire qui préoccupe Josef Schuster et sans laquelle un sentiment de persécution ou une volonté de détachement ne pourrait naître. Louis Huguet va même jusqu’à dire que Josef Schuster aurait le sentiment d’une « responsabilité collective » (88). Robert Schuster lie à plusieurs reprises le destin de son frère et celui de son peuple, lorsqu’il dit : « ce qui me sidère c’est que le peuple autrichien tout entier / ne se soit pas suicidé depuis longtemps » (89), ou encore « comme tous les Autrichiens sont malheureux / on ne peut pas dire / que lui seul ait été un homme malheureux »(90), ce qui n’est pas sans rappeler la relation intime qu’établit Bernhard entre le « suicide » et le « suicide des peuples » (91).
L’artiste-observateur se détache de la réalité pour y voir plus clair – une opération antinomique avec le théâtre en tant qu’art mimétique. Pour atteindre à une forme d’authenticité, il faut s’extraire du monde, « chercher hors de la chaîne du temps » (73), voilà pourquoi Josef Schuster préfère la musique en tant qu’art immatériel au théâtre, qui est associé à la fausseté. L’authenticité des crises de Madame Schuster est mise en doute (74), peut-être parce qu’elle s’est occupé de ses usines à défaut de son intellect (75), ce qui lui vaut un caractère terrestre incapable d’abstraction. En disant que « celui qui a une fois flairé le sang au théâtre / ne peut plus exister sans théâtre » (76), Josef Schuster cité par Madame Zittel évoque la dérive de l’esprit dans la bassesse et le ridicule de l’art mimétique à laquelle obéissent notamment les institutions comme le gouvernement et l’Église qui sont associées au théâtre. La même connotation négative est attribuée à l’enterrement du professeur – un « théâtre de la mort » « pompeux », « repoussant », « niais » –, et à la Niederreiter, une comédienne que fréquente le fils de Josef Schuster, Lukas, au grand désespoir de son oncle (77). Tout à Vienne, qui n’est plus une ville de l’esprit depuis la guerre, est décrit comme « artificiellement gonflé et vulgaire » (78) par Robert Schuster. En les balayant du regard, il mêle indistinctement dans la même triste comédie les lieux de représentation que sont le Burgtheater et le Parlement, décor de la seconde scène. La vue du Parlement qui entraîne Robert Schuster à comparer la politique à une « comédie » (79) nourrit son idée selon laquelle l’Autriche de 1988 est toujours nazie. Plus tôt, il évoque également ce qui pourrait être la quintessence théâtrale de l’histoire autrichienne, soit l’Autriche nazie, en parlant d’un « metteur en scène », qui n’est pas sans rappeler Hitler, pour les « figurants » que sont le peuple autrichien (80). Le seul théâtre perçu positivement est celui de l’innocence, dépourvu d’« affectation » (81), le « vrai théâtre » (82) dans lequel jouaient les frères Schuster dans leur prime jeunesse. L’enfance acquiert de la valeur parce qu’elle est située dans le passé. Les « paysages » de « l’enfance perdue » (83) sont un espace clos et inaccessible à l’expérience immédiate, si ce n’est celle de la nostalgie, celle que Bernhard lui-même éprouve en évoquant ses racines.
Le caractère vivant du théâtre de l’innocence qui ne peut s’actualiser dans le réel entre en contraste avec le statisme du théâtre bourgeois qui jouit, inversement, d’une grande représentativité. La musique que Josef Schuster persiste à écouter permet de sortir de la réalité, alors que le mimétisme du théâtre condamne à répéter ce qui est déjà advenu, comme si le monde n’était fait que de modèles et d’imitateurs et jamais de vie véritablement vécue, comme peut le suggérer d’autre part le mode citationnel de la pièce. Chez Bernhard, la haute culture qui obéit à ce cycle conservateur et réactionnaire de la tradition et de la sacralisation subit d’ailleurs, dans les mots de Tim Reuter, une forme de « carnavalisation » (84). L’un de ses représentants est le théâtre allemand : Lukas Schuster qualifie tour à tour Minna von Barnhelm et Nathan le Sage de Lessing d’« insipide », de « théâtre de divertissement », de « risible » et de « pathétique mensonger » (85). Le terme d’« opérette », employé par Bernhard dans un article intitulé « Salzbourg attend une pièce de théâtre » (1955) – une véhémente critique du manque de renouvellement de la programmation du théâtre de Salzbourg –, sert à dénigrer le théâtre tant au Burgtheater qu’à Josefstadt, que Madame Schuster a l’habitude de fréquenter.
L’une des voies possibles pour échapper au cycle « digestif » du théâtre, dans les termes d’Anna Schuster en écho à Artaud (86), serait d’éviter un théâtre d’identification en tentant de couper les liens entre les mots et le réel. Se terrer dans l’Autre, la négation de soi, le pessimisme, le suicide reviendrait à se terrer dans la non-représentativité : un théâtre sans « saut » donc, mais surtout, sans psychologisation trop élaborée des personnages. Plurivoques mais distincts les uns des autres, les personnages de la pièce, en particulier les frères Schuster, font preuve d’une telle exagération qu’ils sont aisément discrédités, comme le rappelle Thorsten Themann (87). Bien que Josef Schuster soit misanthrope, son suicide a une portée collective, sans être pour autant revendicateur. Si la critique du théâtre dans la pièce renvoie à une critique de l’immobilisme autrichien, les notions d’héritage et d’attachement au passé ne sont pas pour autant rejetées en bloc. Le dégoût qu’éprouvent les Schuster provient par ailleurs du fait qu’à leurs yeux l’Autriche contemporaine n’est pas digne de son héritage. Cette conscience historique va de pair avec la question de l’appartenance à un groupe et à une histoire qui préoccupe Josef Schuster et sans laquelle un sentiment de persécution ou une volonté de détachement ne pourrait naître. Louis Huguet va même jusqu’à dire que Josef Schuster aurait le sentiment d’une « responsabilité collective » (88). Robert Schuster lie à plusieurs reprises le destin de son frère et celui de son peuple, lorsqu’il dit : « ce qui me sidère c’est que le peuple autrichien tout entier / ne se soit pas suicidé depuis longtemps » (89), ou encore « comme tous les Autrichiens sont malheureux / on ne peut pas dire / que lui seul ait été un homme malheureux »(90), ce qui n’est pas sans rappeler la relation intime qu’établit Bernhard entre le « suicide » et le « suicide des peuples » (91).
Conclusion. Poursuite de la scène
Place des Héros prend forme par décalages. D’abord, le scandale que provoque la pièce connaît son plus grand retentissement dans la société autrichienne avant même la première, car des extraits sont publiés dans Profil le 1er août 1988 – avec ou sans l’autorisation de Bernhard, le doute est encore permis – donnant lieu à une mise en scène de la représentation de la pièce. La pièce en elle-même est un après-coup du suicide, auquel assiste le public seulement à travers le filtre des personnages sur scène, ce qui l’installe d’emblée hors de l’ethos du drame. La vie n’est pas un début ni la mort une fin, l’existence de l’« homme d’esprit » Josef Schuster qui suinte à travers le texte de la pièce est davantage aux prises avec une impossible réconciliation du corps et de l’esprit. Dans l’appartement à moitié vide où, dans une Vienne dont « l’apogée poétique » (92) est désormais chose du passé, le temps suspendu perd de sa valeur et le sens d’un coup de tête se mesure à celui de l’activité soutenue de l’œuvre d’une vie. Il reste ces écarts passagers avec le réel : la musique, l’enfance, la folie, « le Kohlmarkt », « le Graben » ou « la Singerstrasse dans l’air du printemps » (93) qui permettent de transcender le théâtre du monde, ou la « comédie du monde » (Weltkomödie), expression employée par Claus Peymann pour décrire les événements autour du scandale de Place des Héros (94). Ou alors faut-il s’y engouffrer de manière à mieux y jouer, comme le suggère Ingeborg Bachmann : « tant qu’on ne sait pas ce qui est incurable, on ne pourra s’attaquer à rien du tout » (95) ? Même s’il est déplorable, le théâtre est aussi, comme la mort, un instrument de mise à distance de la vie.
Catherine GIRARDIN
Université Paris Ouest Nanterre La Défense/Université Goethe de Francfort
Catherine GIRARDIN
Université Paris Ouest Nanterre La Défense/Université Goethe de Francfort
Notes et bibliographie
(1) Thomas Bernhard, « Sur les traces de la vérité et de la mort » (1967), Sur les traces de la vérité : discours, lettres, entretiens, articles, dir. Wolfram Bayer, Raimund Fellinger et Martin Huber, trad. Daniel Mirsky, Paris, Gallimard, 2013, p. 88.
(2) Thomas Bernhard, Place des Héros, trad. Claude Porcell, Paris, L’Arche, 1990, p. 11.
(3) Ibid., p. 154.
(4) Ibid., p. 168.
(5) Chantal Thomas, Thomas Bernhard le briseur de silence, Paris, Seuil, 2006, coll. Fiction & Cie., p. 179.
(6) Thorsten Themann, Heldenplatz, Munich, Oldenbourg, 2004, coll. Oldenbourg Interpretationen, vol. 101, p. 14-15.
(7) Dossier de presse sur le scandale de Place des Héros disponible sur le site : http://www.graphix.at/bernhard/analyse.html. Voir aussi : Burgtheater (éd.), Heldenplatz : Eine Dokumentation, Vienne, Burgtheater, 1989.
(8) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 99.
(9) Ibid., p. 90.
(10) Ibid., p. 117.
(11) Dagmar Lorenz, « The Established Outsider : Thomas Bernhard », A Companion to the Works of Thomas Bernhard, éd. Matthias Konzett, Rochester, Camden House, 2002, coll. Studies in German Literature, Linguistics, and Culture, p. 42.
(12) Jean-Marie Winkler, L’Attente et la fête : recherches sur le théâtre de Thomas Bernhard, Paris, Peter Lang, 1989, p. 52.
(13) Thomas Bernhard, « Prix national autrichien » (1968), Ténèbres : textes, discours, entretien, suivis d’un dossier « À la rencontre de Thomas Bernhard », dir. Claude Porcell, Paris, Lettres Nouvelles/Maurice Nadeau, 1986, p. 41.
(14) Thomas Bernhard, « Trois jours » (1971), Ténèbres : textes, discours, entretien, suivis d’un dossier « À la rencontre de Thomas Bernhard », dir. Claude Porcell, Paris, Lettres Nouvelles/Maurice Nadeau, 1986, p. 60-61.
(15) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 82.
(16) Thomas Bernhard, Gel, trad. Josée Turk-Meyer et Boris Simon, Paris, Gallimard, 1967, p. 298.
(17) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 108.
(18) Marc Moser, « La Mort renvoie à la vie » Thomas Bernhard et les siens, éd. Gemma Salem, Paris, La Table ronde, 2005, p. 63.
(19) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 93.
(20) In : Erika Tunner, Thomas Bernhard. Un joyeux mélancolique, Paris, L’Harmattan, 2004, coll. Les Mondes germaniques, p. 23.
(21) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 15.
(22) Ibid., p. 16.
(23) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 43.
(24) Thomas Bernhard, Heldenplatz, Francfort, Suhrkamp, 1989, p. 41.
(25) Ibid., p. 26.
(26) Ibid., p. 39.
(27) Thorsten Themann, op. cit., p. 49.
(28) Jean-Pierre Sarrazac, Théâtres intimes : essai, Arles, Actes Sud, 1989, coll. Le Temps du théâtre, p. 135.
(29) Thomas Bernhard, entretien par André Müller, « Entretien avec Thomas Bernhard », Ténèbres : textes, discours, entretien, suivis d’un dossier « À la rencontre de Thomas Bernhard », dir. Claude Porcell, Paris, Lettres Nouvelles/Maurice Nadeau, 1986, p. 97.
(30) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 168.
(31) Ibid., p. 90.
(32) Jean-Patrice Courtois, « Le “oui” et le “non”. Goethe, Nietzsche et Bernhard », Europe, dir. Charles Dobzynski, 2009, p. 172.
(33) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 13.
(34) Erika Tunner, op.cit., p. 20.
(35) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 107.
(36) Ibid., p. 168.
(37) Ibid., p. 114.
(38) Ibid., p. 118.
(39) Thorsten Themann, op. cit., p. 92.
(40) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 24.
(41) Ibid., p. 33.
(42) Ibid., p. 33.
(43) Thomas Bernhard, « Sur les traces de la vérité et de la mort » (1967), op.cit., p. 83.
(44) Thomas Bernhard, « Trois jours » (1971), op. cit., p. 67.
(45) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 118.
(46) Ibid., p. 72.
(47) Johannes Freumbichler (grand-père de Bernhard) cité par Tunner, Erika, op. cit., p. 21.
(48) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 60.
(49) Thomas Mann, « Tonio Kröger », Romans et nouvelles I. 1896-1903, trad. Félix Bertaux, Geneviève Maury et Charles Sigwalt, Paris, Librairie générale française, 1994, coll. Classiques modernes, p. 230.
(50) Thomas Bernhard, entretien par André Müller, op.cit., p. 71.
(51) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 45.
(52) Ibid., p. 83.
(53) Ibid., p. 88.
(54) Ibid., p. 45.
(55) Ibid., p. 83.
(56) Ibid., p. 22.
(57) Ibid., p. 154.
(58) Krystian Lupa, « Journal d’un metteur en scène. Juillet 1999 », Europe, dir. Charles Dobzynski, 2009, p. 202.
(59) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 87.
(60) Ibid., p. 89.
(61) Ibid., p. 16.
(62) Ibid., p. 28.
(63) Ibid., p. 48.
(64) Ibid., p. 94.
(65) Ibid., p. 14.
(66) Ibid., p. 20.
(67) Thorsten Themann, op. cit., p. 22.
(68) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 48.
(69) Claude Porcell, « Chronologie », Ténèbres : textes, discours, entretien, suivis d’un dossier « À la rencontre de Thomas Bernhard », dir. Claude Porcell, Paris, Lettres Nouvelles/Maurice Nadeau, 1986, p. 14.
(70) Thomas Bernhard, « Trois jours » (1971), op.cit., p. 60-61.
(71) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 78.
(72) Thomas Bernhard, « Oraison politique du matin » (1966), Sur les traces de la vérité : discours, lettres, entretiens, articles, dir. Wolfram Bayer, Raimund Fellinger et Martin Huber, trad. Daniel Mirsky, Paris, Gallimard, 2013, p. 50.
(73) Martine Sforzin, L’Art de l'irritation chez Thomas Bernhard : ars moriendi, modus vivendi, Arras, Artois Presses Université, 2002, p. 121.
(74) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 70.
(75) Ibid., p. 69.
(76) Ibid., p. 25.
(77) Ibid., p. .138.
(78) Ibid., p. 169.
(79) Ibid., p. 99.
(80) Ibid., p. 91.
(81) Ibid., p. 164.
(82) Ibid., p. 97.
(83) Thomas Bernhard, « L’immortalité est impossible » (1968), Sur les traces de la vérité : discours, lettres, entretiens, articles, dir. Wolfram Bayer, Raimund Fellinger et Martin Huber, trad. Daniel Mirsky, Paris, Gallimard, 2013, p. 57.
(84) Tim Reuter, « Vaterland, Unsinn » Thomas Bernhards (ent-) nationalisierte Genieästhetik zwischen Österreich-Gebundenheit und Österreich-Entbundenheit, Wurtzbourg, Königshausen & Neumann, coll. Film-Medium-Diskurs, vol. 44, p. 324.
(85) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 157.
(86) Ibid., p. 69.
(87) Thorsten Themann, op. cit., p. 52.
(88) Louis Huguet, Thomas Bernhard ou le Silence du sphinx, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, Cahiers de l’Université de Perpignan, éd. Werner Burzlaff, 1991, 2e semestre, n°11, p. 44.
(89) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 90.
(90) Ibid., p. 171.
(91) Thomas Bernhard, « Sur les traces de la vérité et de la mort » (1967), op. cit., p. 88.
(92) Thomas Bernhard, « Oraison politique du matin » (1966), op. cit., p. 49.
(93) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 153.
(94) Charles W. Martin, The Nihilism of Thomas Bernhard. The Portrayal of Existential and Social Problems in his Prose Works, Amsterdam, Rodopi, 1995, p. 212.
(95) Ingeborg Bachmann, « Esquisse », Europe, dir. Charles Dobzynski, 2009, p. 146-147.
Bibliographie
BACHMANN, Ingeborg, « Esquisse », Europe, dir. Charles Dobzynski, 2009, p. 145-147.
BERNHARD, Thomas, entretien par André Müller, « Entretien avec Thomas Bernhard », Ténèbres : textes, discours, entretien, suivis d’un dossier « À la rencontre de Thomas Bernhard », dir. Claude Porcell, Paris, Lettres Nouvelles/Maurice Nadeau, 1986, p. 71-118.
BERNHARD, Thomas, Gel, trad. Josée Turk-Meyer et Boris Simon, Paris, Gallimard, 1967.
BERNHARD, Thomas, Heldenplatz, Francfort, Suhrkamp, 1989.
BERNHARD, Thomas, « L’immortalité est impossible » (1968), Sur les traces de la vérité : discours, lettres, entretiens, articles, dir. Wolfram Bayer, Raimund Fellinger et Martin Huber, trad. Daniel Mirsky, Paris, Gallimard, 2013, p. 54-62.
BERNHARD, Thomas, « Oraison politique du matin » (1966), Sur les traces de la vérité : discours, lettres, entretiens, articles, dir. Wolfram Bayer, Raimund Fellinger et Martin Huber, trad. Daniel Mirsky, Paris, Gallimard, 2013, p. 47-53.
BERNHARD, Thomas, Place des Héros, trad. Claude Porcell, Paris, L’Arche, 1990.
BERNHARD, Thomas, « Prix national autrichien » (1968), Ténèbres : textes, discours, entretien, suivis d’un dossier « À la rencontre de Thomas Bernhard », dir. Claude Porcell, Paris, Lettres Nouvelles/Maurice Nadeau, 1986, p. 33-44.
BERNHARD, Thomas, « Sur les traces de la vérité et de la mort » (1967), Sur les traces de la vérité : discours, lettres, entretiens, articles, dir. Wolfram Bayer, Raimund Fellinger et Martin Huber, trad. Daniel Mirsky, Paris, Gallimard, 2013, p. 83-92.
BERNHARD, Thomas, « Trois jours » (1971), Ténèbres : textes, discours, entretien, suivis d’un dossier « À la rencontre de Thomas Bernhard », dir. Claude Porcell, Paris, Lettres Nouvelles/Maurice Nadeau, 1986, p. 57-70.
BURGTHEATER (éd.), Heldenplatz : Eine Dokumentation, Vienne, Burgtheater, 1989.
COURTOIS, Jean-Patrice, « Le “oui” et le “non”. Goethe, Nietzsche et Bernhard », Europe, dir. Charles Dobzynski, 2009, p. 162-175.
HUGUET, Louis, Thomas Bernhard ou le Silence du sphinx, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, Cahiers de l’Université de Perpignan, éd. Werner Burzlaff, 1991, 2e semestre, n°11.
LORENZ, Dagmar, « The Established Outsider : Thomas Bernhard », A Companion to the Works of Thomas Bernhard, éd. Matthias Konzett, Rochester, Camden House, 2002, coll. Studies in German Literature, Linguistics, and Culture, p. 29-50.
LUPA, Krystian, « Journal d’un metteur en scène. Juillet 1999 », Europe, dir. Charles Dobzynski, 2009, p. 200-204.
MANN, Thomas, « Tonio Kröger », Romans et nouvelles I. 1896-1903, trad. Félix Bertaux, Geneviève Maury et Charles Sigwalt, Paris, Librairie générale française, 1994, coll. Classiques modernes.
MARTIN, Charles W., The Nihilism of Thomas Bernhard. The Portrayal of Existential and Social Problems in his Prose Works, Amsterdam, Rodopi, 1995.
MOSER, Marc, « La Mort renvoie à la vie », Thomas Bernhard et les siens, éd. Gemma Salem, Paris, La Table ronde, 2005, p. 59-64.
PORCELL, Claude, « Chronologie », Ténèbres : textes, discours, entretien, suivis d’un dossier « À la rencontre de Thomas Bernhard », dir. Claude Porcell, Paris, Lettres Nouvelles/Maurice Nadeau, 1986, p. 11-20.
REUTER, Tim, « Vaterland, Unsinn » Thomas Bernhards (ent-)nationalisierte Genieästhetik zwischen Österreich-Gebundenheit und Österreich-Entbundenheit, Wurtzbourg, Königshausen & Neumann, coll. Film-Medium-Diskurs, vol. 44.
SARRAZAC, Jean-Pierre, Théâtres intimes : essai, Arles, Actes Sud, 1989, coll. Le Temps du théâtre.
SFORZIN, Martine, L’Art de l'irritation chez Thomas Bernhard : ars moriendi, modus vivendi, Arras, Artois Presses Université, 2002.
THEMANN, Thorsten, Heldenplatz, Munich, Oldenbourg, 2004, Oldenbourg Interpretationen Band 101.
THOMAS, Chantal, Thomas Bernhard le briseur de silence, Paris, Seuil, 2006, coll. Fiction & Cie.
TUNNER, Erika, Thomas Bernhard. Un joyeux mélancolique, Paris, L’Harmattan, 2004, coll. Les Mondes germaniques.
WINKLER, Jean-Marie, L’Attente et la fête : recherches sur le théâtre de Thomas Bernhard, Paris, Peter Lang, 1989.
http://www.graphix.at/bernhard/analyse.html
(2) Thomas Bernhard, Place des Héros, trad. Claude Porcell, Paris, L’Arche, 1990, p. 11.
(3) Ibid., p. 154.
(4) Ibid., p. 168.
(5) Chantal Thomas, Thomas Bernhard le briseur de silence, Paris, Seuil, 2006, coll. Fiction & Cie., p. 179.
(6) Thorsten Themann, Heldenplatz, Munich, Oldenbourg, 2004, coll. Oldenbourg Interpretationen, vol. 101, p. 14-15.
(7) Dossier de presse sur le scandale de Place des Héros disponible sur le site : http://www.graphix.at/bernhard/analyse.html. Voir aussi : Burgtheater (éd.), Heldenplatz : Eine Dokumentation, Vienne, Burgtheater, 1989.
(8) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 99.
(9) Ibid., p. 90.
(10) Ibid., p. 117.
(11) Dagmar Lorenz, « The Established Outsider : Thomas Bernhard », A Companion to the Works of Thomas Bernhard, éd. Matthias Konzett, Rochester, Camden House, 2002, coll. Studies in German Literature, Linguistics, and Culture, p. 42.
(12) Jean-Marie Winkler, L’Attente et la fête : recherches sur le théâtre de Thomas Bernhard, Paris, Peter Lang, 1989, p. 52.
(13) Thomas Bernhard, « Prix national autrichien » (1968), Ténèbres : textes, discours, entretien, suivis d’un dossier « À la rencontre de Thomas Bernhard », dir. Claude Porcell, Paris, Lettres Nouvelles/Maurice Nadeau, 1986, p. 41.
(14) Thomas Bernhard, « Trois jours » (1971), Ténèbres : textes, discours, entretien, suivis d’un dossier « À la rencontre de Thomas Bernhard », dir. Claude Porcell, Paris, Lettres Nouvelles/Maurice Nadeau, 1986, p. 60-61.
(15) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 82.
(16) Thomas Bernhard, Gel, trad. Josée Turk-Meyer et Boris Simon, Paris, Gallimard, 1967, p. 298.
(17) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 108.
(18) Marc Moser, « La Mort renvoie à la vie » Thomas Bernhard et les siens, éd. Gemma Salem, Paris, La Table ronde, 2005, p. 63.
(19) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 93.
(20) In : Erika Tunner, Thomas Bernhard. Un joyeux mélancolique, Paris, L’Harmattan, 2004, coll. Les Mondes germaniques, p. 23.
(21) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 15.
(22) Ibid., p. 16.
(23) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 43.
(24) Thomas Bernhard, Heldenplatz, Francfort, Suhrkamp, 1989, p. 41.
(25) Ibid., p. 26.
(26) Ibid., p. 39.
(27) Thorsten Themann, op. cit., p. 49.
(28) Jean-Pierre Sarrazac, Théâtres intimes : essai, Arles, Actes Sud, 1989, coll. Le Temps du théâtre, p. 135.
(29) Thomas Bernhard, entretien par André Müller, « Entretien avec Thomas Bernhard », Ténèbres : textes, discours, entretien, suivis d’un dossier « À la rencontre de Thomas Bernhard », dir. Claude Porcell, Paris, Lettres Nouvelles/Maurice Nadeau, 1986, p. 97.
(30) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 168.
(31) Ibid., p. 90.
(32) Jean-Patrice Courtois, « Le “oui” et le “non”. Goethe, Nietzsche et Bernhard », Europe, dir. Charles Dobzynski, 2009, p. 172.
(33) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 13.
(34) Erika Tunner, op.cit., p. 20.
(35) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 107.
(36) Ibid., p. 168.
(37) Ibid., p. 114.
(38) Ibid., p. 118.
(39) Thorsten Themann, op. cit., p. 92.
(40) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 24.
(41) Ibid., p. 33.
(42) Ibid., p. 33.
(43) Thomas Bernhard, « Sur les traces de la vérité et de la mort » (1967), op.cit., p. 83.
(44) Thomas Bernhard, « Trois jours » (1971), op. cit., p. 67.
(45) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 118.
(46) Ibid., p. 72.
(47) Johannes Freumbichler (grand-père de Bernhard) cité par Tunner, Erika, op. cit., p. 21.
(48) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 60.
(49) Thomas Mann, « Tonio Kröger », Romans et nouvelles I. 1896-1903, trad. Félix Bertaux, Geneviève Maury et Charles Sigwalt, Paris, Librairie générale française, 1994, coll. Classiques modernes, p. 230.
(50) Thomas Bernhard, entretien par André Müller, op.cit., p. 71.
(51) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 45.
(52) Ibid., p. 83.
(53) Ibid., p. 88.
(54) Ibid., p. 45.
(55) Ibid., p. 83.
(56) Ibid., p. 22.
(57) Ibid., p. 154.
(58) Krystian Lupa, « Journal d’un metteur en scène. Juillet 1999 », Europe, dir. Charles Dobzynski, 2009, p. 202.
(59) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 87.
(60) Ibid., p. 89.
(61) Ibid., p. 16.
(62) Ibid., p. 28.
(63) Ibid., p. 48.
(64) Ibid., p. 94.
(65) Ibid., p. 14.
(66) Ibid., p. 20.
(67) Thorsten Themann, op. cit., p. 22.
(68) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 48.
(69) Claude Porcell, « Chronologie », Ténèbres : textes, discours, entretien, suivis d’un dossier « À la rencontre de Thomas Bernhard », dir. Claude Porcell, Paris, Lettres Nouvelles/Maurice Nadeau, 1986, p. 14.
(70) Thomas Bernhard, « Trois jours » (1971), op.cit., p. 60-61.
(71) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 78.
(72) Thomas Bernhard, « Oraison politique du matin » (1966), Sur les traces de la vérité : discours, lettres, entretiens, articles, dir. Wolfram Bayer, Raimund Fellinger et Martin Huber, trad. Daniel Mirsky, Paris, Gallimard, 2013, p. 50.
(73) Martine Sforzin, L’Art de l'irritation chez Thomas Bernhard : ars moriendi, modus vivendi, Arras, Artois Presses Université, 2002, p. 121.
(74) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 70.
(75) Ibid., p. 69.
(76) Ibid., p. 25.
(77) Ibid., p. .138.
(78) Ibid., p. 169.
(79) Ibid., p. 99.
(80) Ibid., p. 91.
(81) Ibid., p. 164.
(82) Ibid., p. 97.
(83) Thomas Bernhard, « L’immortalité est impossible » (1968), Sur les traces de la vérité : discours, lettres, entretiens, articles, dir. Wolfram Bayer, Raimund Fellinger et Martin Huber, trad. Daniel Mirsky, Paris, Gallimard, 2013, p. 57.
(84) Tim Reuter, « Vaterland, Unsinn » Thomas Bernhards (ent-) nationalisierte Genieästhetik zwischen Österreich-Gebundenheit und Österreich-Entbundenheit, Wurtzbourg, Königshausen & Neumann, coll. Film-Medium-Diskurs, vol. 44, p. 324.
(85) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 157.
(86) Ibid., p. 69.
(87) Thorsten Themann, op. cit., p. 52.
(88) Louis Huguet, Thomas Bernhard ou le Silence du sphinx, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, Cahiers de l’Université de Perpignan, éd. Werner Burzlaff, 1991, 2e semestre, n°11, p. 44.
(89) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 90.
(90) Ibid., p. 171.
(91) Thomas Bernhard, « Sur les traces de la vérité et de la mort » (1967), op. cit., p. 88.
(92) Thomas Bernhard, « Oraison politique du matin » (1966), op. cit., p. 49.
(93) Thomas Bernhard, Place des Héros, op. cit., p. 153.
(94) Charles W. Martin, The Nihilism of Thomas Bernhard. The Portrayal of Existential and Social Problems in his Prose Works, Amsterdam, Rodopi, 1995, p. 212.
(95) Ingeborg Bachmann, « Esquisse », Europe, dir. Charles Dobzynski, 2009, p. 146-147.
Bibliographie
BACHMANN, Ingeborg, « Esquisse », Europe, dir. Charles Dobzynski, 2009, p. 145-147.
BERNHARD, Thomas, entretien par André Müller, « Entretien avec Thomas Bernhard », Ténèbres : textes, discours, entretien, suivis d’un dossier « À la rencontre de Thomas Bernhard », dir. Claude Porcell, Paris, Lettres Nouvelles/Maurice Nadeau, 1986, p. 71-118.
BERNHARD, Thomas, Gel, trad. Josée Turk-Meyer et Boris Simon, Paris, Gallimard, 1967.
BERNHARD, Thomas, Heldenplatz, Francfort, Suhrkamp, 1989.
BERNHARD, Thomas, « L’immortalité est impossible » (1968), Sur les traces de la vérité : discours, lettres, entretiens, articles, dir. Wolfram Bayer, Raimund Fellinger et Martin Huber, trad. Daniel Mirsky, Paris, Gallimard, 2013, p. 54-62.
BERNHARD, Thomas, « Oraison politique du matin » (1966), Sur les traces de la vérité : discours, lettres, entretiens, articles, dir. Wolfram Bayer, Raimund Fellinger et Martin Huber, trad. Daniel Mirsky, Paris, Gallimard, 2013, p. 47-53.
BERNHARD, Thomas, Place des Héros, trad. Claude Porcell, Paris, L’Arche, 1990.
BERNHARD, Thomas, « Prix national autrichien » (1968), Ténèbres : textes, discours, entretien, suivis d’un dossier « À la rencontre de Thomas Bernhard », dir. Claude Porcell, Paris, Lettres Nouvelles/Maurice Nadeau, 1986, p. 33-44.
BERNHARD, Thomas, « Sur les traces de la vérité et de la mort » (1967), Sur les traces de la vérité : discours, lettres, entretiens, articles, dir. Wolfram Bayer, Raimund Fellinger et Martin Huber, trad. Daniel Mirsky, Paris, Gallimard, 2013, p. 83-92.
BERNHARD, Thomas, « Trois jours » (1971), Ténèbres : textes, discours, entretien, suivis d’un dossier « À la rencontre de Thomas Bernhard », dir. Claude Porcell, Paris, Lettres Nouvelles/Maurice Nadeau, 1986, p. 57-70.
BURGTHEATER (éd.), Heldenplatz : Eine Dokumentation, Vienne, Burgtheater, 1989.
COURTOIS, Jean-Patrice, « Le “oui” et le “non”. Goethe, Nietzsche et Bernhard », Europe, dir. Charles Dobzynski, 2009, p. 162-175.
HUGUET, Louis, Thomas Bernhard ou le Silence du sphinx, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, Cahiers de l’Université de Perpignan, éd. Werner Burzlaff, 1991, 2e semestre, n°11.
LORENZ, Dagmar, « The Established Outsider : Thomas Bernhard », A Companion to the Works of Thomas Bernhard, éd. Matthias Konzett, Rochester, Camden House, 2002, coll. Studies in German Literature, Linguistics, and Culture, p. 29-50.
LUPA, Krystian, « Journal d’un metteur en scène. Juillet 1999 », Europe, dir. Charles Dobzynski, 2009, p. 200-204.
MANN, Thomas, « Tonio Kröger », Romans et nouvelles I. 1896-1903, trad. Félix Bertaux, Geneviève Maury et Charles Sigwalt, Paris, Librairie générale française, 1994, coll. Classiques modernes.
MARTIN, Charles W., The Nihilism of Thomas Bernhard. The Portrayal of Existential and Social Problems in his Prose Works, Amsterdam, Rodopi, 1995.
MOSER, Marc, « La Mort renvoie à la vie », Thomas Bernhard et les siens, éd. Gemma Salem, Paris, La Table ronde, 2005, p. 59-64.
PORCELL, Claude, « Chronologie », Ténèbres : textes, discours, entretien, suivis d’un dossier « À la rencontre de Thomas Bernhard », dir. Claude Porcell, Paris, Lettres Nouvelles/Maurice Nadeau, 1986, p. 11-20.
REUTER, Tim, « Vaterland, Unsinn » Thomas Bernhards (ent-)nationalisierte Genieästhetik zwischen Österreich-Gebundenheit und Österreich-Entbundenheit, Wurtzbourg, Königshausen & Neumann, coll. Film-Medium-Diskurs, vol. 44.
SARRAZAC, Jean-Pierre, Théâtres intimes : essai, Arles, Actes Sud, 1989, coll. Le Temps du théâtre.
SFORZIN, Martine, L’Art de l'irritation chez Thomas Bernhard : ars moriendi, modus vivendi, Arras, Artois Presses Université, 2002.
THEMANN, Thorsten, Heldenplatz, Munich, Oldenbourg, 2004, Oldenbourg Interpretationen Band 101.
THOMAS, Chantal, Thomas Bernhard le briseur de silence, Paris, Seuil, 2006, coll. Fiction & Cie.
TUNNER, Erika, Thomas Bernhard. Un joyeux mélancolique, Paris, L’Harmattan, 2004, coll. Les Mondes germaniques.
WINKLER, Jean-Marie, L’Attente et la fête : recherches sur le théâtre de Thomas Bernhard, Paris, Peter Lang, 1989.
http://www.graphix.at/bernhard/analyse.html
Profile
Avec deux masters en études théâtrales et en Performance Studies à son actif, Catherine Girardin s’est familiarisée avec les écoles anglo-saxonne et continentale en matière d’analyse des arts vivants. Au cours d’un séminaire sur l’interdisciplinarité, elle s’est intéressée plus particulièrement aux relations entre histoire et théâtre. Avec une approche esthétique et philosophique, sa thèse en cours vise à mettre au jour les dialogues entre les historiens et les dramaturges allemands de la fin du XVIIIe siècle.
With two MAs in Theatre Studies and Performance Studies, Catherine Girardin has explored both schools of thought regarding live arts analysis. During a seminar on interdisciplinarity, she got particularly interested in the relations between history and theatre. With an aesthetical and a philosophical approach, her current PhD thesis seeks to highlight the dialogues between German historians and playwrights at the end of the eighteenth century.
Coordonnées
catherinelaura.girardin@gmail.com
With two MAs in Theatre Studies and Performance Studies, Catherine Girardin has explored both schools of thought regarding live arts analysis. During a seminar on interdisciplinarity, she got particularly interested in the relations between history and theatre. With an aesthetical and a philosophical approach, her current PhD thesis seeks to highlight the dialogues between German historians and playwrights at the end of the eighteenth century.
Coordonnées
catherinelaura.girardin@gmail.com
Publications
2016
>Présentation : « Johann Gottfried Herder’s Critique of the Enlightenment through Theatre » au XIIIème Congrès de la « Gesellschaft für Theaterwissenschaft » sur le thème « Theater als Kritik », Universités Goethe Frankfurt am Main et Justus-Liebig Gießen.
>Présentation : « Interweaving Theatre and History : Herder’s Bückeburg Times », Conférence de la Société internationale Herder (Internationale Herder-Gesellschaft) sur le thème « Herder et les arts » (« Herder und die Künste »), Université de Kassel.
>Article : « Pièce montée de toutes pièces : L’Ile flottante de Christoph Marthaler », Liberté, automne 2016, n°313 : « Séduits par la droite ».
>Présentation : « Johann Gottfried Herder and the Theatre as a Praxis of Philosophy of History », Conférence annuelle de la Fédération internationale de recherche théâtrale (IFTR) sur le thème « Presenting the Theatrical Past », Université de Stockholm.
>Présentation : « Le théâtre de Johann Gottfried Herder : le genre du drame historico-philosophique », Colloque international « Le théâtre à (re)découvrir » (scènes du signe I), KUL, UMCS, Musée Józef Czechowicz, avec le concours de l’Institut Universitaire de France, Lublin (publication chez Peter Lang à suivre).
>Présentation : « La production philosophique et théâtrale de Johann Gottfried Herder dans les années 1770 : La figure de Brutus contre les Lumières », séminaire doctoral EA REIGENN « Diffusion et redéfinition des Lumières au tournant du XVIIIème siècle », Université Paris-Sorbonne, Maison de la recherche.
2015
>Article « La figure de Richard III », Cahiers du Théâtre Français, hiver 2015, vol. 12, n°6.
2014
>Article « Molly, bête domptée », Liberté, hiver 2015, n°306 : « Faire moins avec moins ».
>Présentation sur The Girl Chewing Gum (1976) de John Smith à la conférence « The Image », Université Freie de Berlin.
>Présentation sur Qu’est-ce qui nous arrive ?!? (2013-2014) de Mathilde Monnier et François Olislaeger aux journées d’étude « Corps (in)croyables : la pratique amateur en danse contemporaine », Université de Poitiers.
>Chapitre dans la publication des actes des journées d’étude, Presses universitaires de Rennes (publication 2015).
>Workshop et présentation sur Letzte Tage. Ein Vorabend de Christoph Marthaler au XIIe Congrès de la « Gesellschaft für Theaterwissenschaft » sur le thème « Epistemes des Theaters », Université Ruhr de Bochum.
>Présentation sur La Condamnation de Lucullus de Bertolt Brecht aux journées d’étude « Allemagne année zéro : repenser la modernité artistique à l’aube de la Guerre froide », LISAA Université Marne-la-Vallée.
>Chapitre : « Le ‘débat Lucullus’ (1949-1952) : procès de l’esthétique brechtienne en RDA », La création artistique en Allemagne occupée (1945-1949). Enjeux esthétiques et politiques, éd. Élise Petit, Sampzon : Delatour France, coll. Avant-Gardes, 2015.
>Présentation sur le spectacle SOS du Big Art Group aux journées d’étude « L’acteur face aux écrans », Université Sorbonne Nouvelle-Paris III.
>Article « Vies artificielles », Inter, art actuel, hiver 2014, n°116 : « Transférer l’expérience ».
2013
>Article « Les Chambres communicantes de Jan Lauwers », Jeu, 2012, n°4, (traductions en anglais et en néerlandais).
2012
>Présentation sur le spectacle Produits d’autres circonstances (2009) de Xavier Le Roy à la conférence « Visual Aspects of Performance Practice » par Inter-Disciplinary.net, Salzbourg.
>Chapitre : « From Butoh to Butohs : Produits d’Autres Circonstances (2009) by Xavier Le Roy and the Image Processing of a Body Practice », Embodied Performance : Design, Process, and Narrative, éd. Sadia Zoubir-Shaw, Oxford : Interdisciplinary Press, 2016 ; et Chapitre (e-book) « From Butoh to Butohs : Produits d’Autres Circonstances (2009) by Xavier Leroy and the Image Processing of a Body Practice », Staged Experiences, éd. Arthur Maria Steijn, Ana Penjak et Celia Morgan, Oxford : Interdisciplinary Press, 2014.
2011
>Article « Suivre le lapin blanc », Aparté, automne 2011, n°1.
>Présentation sur l’œuvre de Hasan Elahi à la conférence « Journeys Across Media », Université de Reading.
2010
>Présentation sur le projet Operndorf Afrika (2008) de Christoph Schlingensief aux journées d’étude « World Picture », Université d’Amsterdam.
>Présentation : « Johann Gottfried Herder’s Critique of the Enlightenment through Theatre » au XIIIème Congrès de la « Gesellschaft für Theaterwissenschaft » sur le thème « Theater als Kritik », Universités Goethe Frankfurt am Main et Justus-Liebig Gießen.
>Présentation : « Interweaving Theatre and History : Herder’s Bückeburg Times », Conférence de la Société internationale Herder (Internationale Herder-Gesellschaft) sur le thème « Herder et les arts » (« Herder und die Künste »), Université de Kassel.
>Article : « Pièce montée de toutes pièces : L’Ile flottante de Christoph Marthaler », Liberté, automne 2016, n°313 : « Séduits par la droite ».
>Présentation : « Johann Gottfried Herder and the Theatre as a Praxis of Philosophy of History », Conférence annuelle de la Fédération internationale de recherche théâtrale (IFTR) sur le thème « Presenting the Theatrical Past », Université de Stockholm.
>Présentation : « Le théâtre de Johann Gottfried Herder : le genre du drame historico-philosophique », Colloque international « Le théâtre à (re)découvrir » (scènes du signe I), KUL, UMCS, Musée Józef Czechowicz, avec le concours de l’Institut Universitaire de France, Lublin (publication chez Peter Lang à suivre).
>Présentation : « La production philosophique et théâtrale de Johann Gottfried Herder dans les années 1770 : La figure de Brutus contre les Lumières », séminaire doctoral EA REIGENN « Diffusion et redéfinition des Lumières au tournant du XVIIIème siècle », Université Paris-Sorbonne, Maison de la recherche.
2015
>Article « La figure de Richard III », Cahiers du Théâtre Français, hiver 2015, vol. 12, n°6.
2014
>Article « Molly, bête domptée », Liberté, hiver 2015, n°306 : « Faire moins avec moins ».
>Présentation sur The Girl Chewing Gum (1976) de John Smith à la conférence « The Image », Université Freie de Berlin.
>Présentation sur Qu’est-ce qui nous arrive ?!? (2013-2014) de Mathilde Monnier et François Olislaeger aux journées d’étude « Corps (in)croyables : la pratique amateur en danse contemporaine », Université de Poitiers.
>Chapitre dans la publication des actes des journées d’étude, Presses universitaires de Rennes (publication 2015).
>Workshop et présentation sur Letzte Tage. Ein Vorabend de Christoph Marthaler au XIIe Congrès de la « Gesellschaft für Theaterwissenschaft » sur le thème « Epistemes des Theaters », Université Ruhr de Bochum.
>Présentation sur La Condamnation de Lucullus de Bertolt Brecht aux journées d’étude « Allemagne année zéro : repenser la modernité artistique à l’aube de la Guerre froide », LISAA Université Marne-la-Vallée.
>Chapitre : « Le ‘débat Lucullus’ (1949-1952) : procès de l’esthétique brechtienne en RDA », La création artistique en Allemagne occupée (1945-1949). Enjeux esthétiques et politiques, éd. Élise Petit, Sampzon : Delatour France, coll. Avant-Gardes, 2015.
>Présentation sur le spectacle SOS du Big Art Group aux journées d’étude « L’acteur face aux écrans », Université Sorbonne Nouvelle-Paris III.
>Article « Vies artificielles », Inter, art actuel, hiver 2014, n°116 : « Transférer l’expérience ».
2013
>Article « Les Chambres communicantes de Jan Lauwers », Jeu, 2012, n°4, (traductions en anglais et en néerlandais).
2012
>Présentation sur le spectacle Produits d’autres circonstances (2009) de Xavier Le Roy à la conférence « Visual Aspects of Performance Practice » par Inter-Disciplinary.net, Salzbourg.
>Chapitre : « From Butoh to Butohs : Produits d’Autres Circonstances (2009) by Xavier Le Roy and the Image Processing of a Body Practice », Embodied Performance : Design, Process, and Narrative, éd. Sadia Zoubir-Shaw, Oxford : Interdisciplinary Press, 2016 ; et Chapitre (e-book) « From Butoh to Butohs : Produits d’Autres Circonstances (2009) by Xavier Leroy and the Image Processing of a Body Practice », Staged Experiences, éd. Arthur Maria Steijn, Ana Penjak et Celia Morgan, Oxford : Interdisciplinary Press, 2014.
2011
>Article « Suivre le lapin blanc », Aparté, automne 2011, n°1.
>Présentation sur l’œuvre de Hasan Elahi à la conférence « Journeys Across Media », Université de Reading.
2010
>Présentation sur le projet Operndorf Afrika (2008) de Christoph Schlingensief aux journées d’étude « World Picture », Université d’Amsterdam.
Projet de thèse
Bien qu’il soit généralement admis que la majeure partie du débat sur l’historisme, compris comme une prise de conscience moderne de l’historicité des sociétés, a eu lieu à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, une pensée réflexive sur l’histoire et son écriture se développe en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle, en parallèle avec le développement d’un théâtre dit « national ». Cette thèse a pour but d’observer les changements dans le traitement par différents auteurs, en particulier Johann Gottfried Herder, de sujets historiques à la fois en histoire et en théâtre, notamment la bataille de Teutobourg. Elle étudie également la théorie développée à l’époque autour de notions communes au théâtre et à l’historiographie, soit la prise de parti pour l’objectivité ou la subjectivité de l’auteur et de son écriture, ainsi que la divergence des approches généralisante et individualisante en ce qui a trait aux événements historiques.
It is generally admitted that most of the debate around historism, understood as the modern development of a consciousness of the societies’ historicity, has been going on during the second half of the nineteenth century. However, questions were being raised on history and the writing of history in a reflexive manner in Germany at the end of the eighteenth century, in parallel with the development of a proper « national » theatre. This thesis aims at observing the changes in different authors’, more particularly Herder’s, ways of approaching historical topics, both in theatre and history, such as the Teutoburg battle. It also takes into account theories that have been written at the time on notions that are common to historiography and theatre, be it the inclinations towards the author’s objectivity or subjectivity, or the divergence between the generalising and the individualising approaches to historical events.
It is generally admitted that most of the debate around historism, understood as the modern development of a consciousness of the societies’ historicity, has been going on during the second half of the nineteenth century. However, questions were being raised on history and the writing of history in a reflexive manner in Germany at the end of the eighteenth century, in parallel with the development of a proper « national » theatre. This thesis aims at observing the changes in different authors’, more particularly Herder’s, ways of approaching historical topics, both in theatre and history, such as the Teutoburg battle. It also takes into account theories that have been written at the time on notions that are common to historiography and theatre, be it the inclinations towards the author’s objectivity or subjectivity, or the divergence between the generalising and the individualising approaches to historical events.