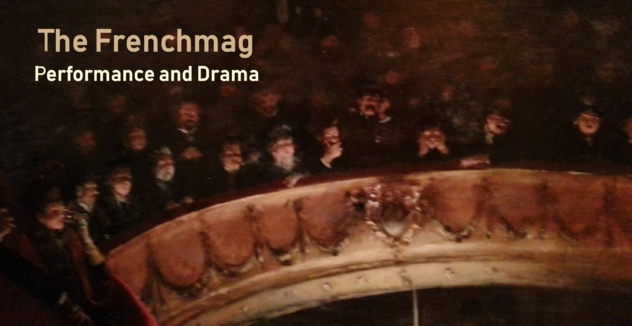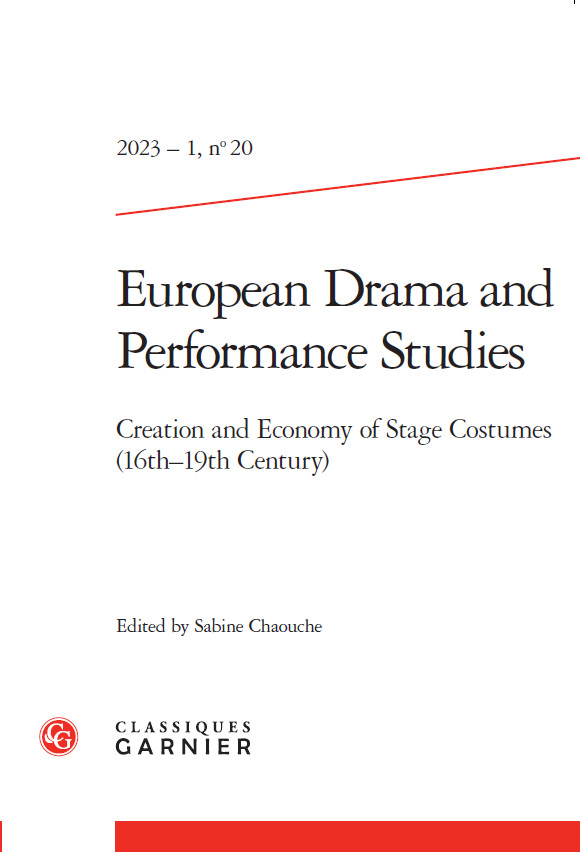Métro : Lignes 4 et 10 (Odéon)
Bus : Lignes 58, 63, 70, 86, 87, 96
Sous la direction de M. le Professeur Pierre Frantz
(Université Paris-Sorbonne)
Membres du jury :
M. le Professeur Olivier Bara (Université Lyon 2)
M. le Professeur Christian Biet (Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense, IUF)
Mme la Professeure Mara Fazio (Università di Roma, La Sapienza, Italie)
M. le Professeur Georges Forestier (Université Paris-Sorbonne, IUF)
M. Pierre Frantz (Université Paris-Sorbonne)
Mme la Professeure Isabelle Moindrot (Université Paris 8)
Mme la Professeure Florence Naugrette (Université de Rouen)
Bus : Lignes 58, 63, 70, 86, 87, 96
Sous la direction de M. le Professeur Pierre Frantz
(Université Paris-Sorbonne)
Membres du jury :
M. le Professeur Olivier Bara (Université Lyon 2)
M. le Professeur Christian Biet (Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense, IUF)
Mme la Professeure Mara Fazio (Università di Roma, La Sapienza, Italie)
M. le Professeur Georges Forestier (Université Paris-Sorbonne, IUF)
M. Pierre Frantz (Université Paris-Sorbonne)
Mme la Professeure Isabelle Moindrot (Université Paris 8)
Mme la Professeure Florence Naugrette (Université de Rouen)
Bio-bibliographie
Docteure en Esthétique, Sciences et Technologies des arts de l’Université Paris 8, Roxane Martin est actuellement maître de conférences en études théâtrales à l’Université de Nice-Sophia Antipolis et membre du CTEL. Spécialiste du théâtre français du XIXe siècle, elle est l’auteure de La Féerie romantique sur les scènes parisiennes, 1791-1864 (Champion, 2007, prix Georges-Jamati et prix de l’Académie française Roland de Jouvenel) et dirige actuellement l’édition critique du Théâtre complet de René-Charles Guilbert de Pixerécourt (Classiques-Garnier). Elle a aussi contribué à de nombreux ouvrages collectifs sur le théâtre de l’époque romantique.
Construire une histoire du théâtre français au XIXe siècle : l’analyse du spectaculaire comme méthode historiographique
Cette habilitation à diriger des recherches s’inscrit dans le cadre des préoccupations actuelles des historiens du théâtre. Depuis plusieurs années, des investigations d’envergure ont été menées, visant à réhabiliter des artistes et des répertoires longtemps oubliés. La réévaluation des outils et des méthodes de l’historiographie des spectacles a conduit à rendre compte des implications à la fois esthétiques, politiques et sociologiques d’un art scénique conçu comme pratique spectaculaire et culturelle au sens large.
Cette recherche abonde dans ce sens. L’élaboration d’une méthode d’analyse des oeuvres théâtrales du XIXe siècle français, fondée sur le croisement des documents conservés autour de leurs représentations (manuscrits de la censure et du souffleur, livrets de mise en scène, partitions d’orchestre, iconographies, maquettes de décors et de costumes…), a permis d’identifier la grammaire scénique de genres longtemps mésestimés par la critique littéraire. Féerie, vaudeville et mélodrame ne pouvaient plus, de la sorte, être dépréciés pour leur usage excessif des techniques de l’illusion, mais se posaient au contraire comme des formes qui avaient exploré la plasticité du langage et, par ce biais, conduit à affranchir l’écriture théâtrale des conventions académiques. Les relais entre parole, geste, son et image, une fois circonscrits, ont favorisé une lecture renouvelée du paysage théâtral de l’époque ; la prise en compte du spectaculaire et de la manière dont il a modelé l’écriture dramatique s’est offert comme un outil favorable pour construire une histoire du théâtre fondée sur la dimension scénique des oeuvres.
Cette méthode d’analyse a favorisé l’écriture d’un essai sur L’Émergence du concept de « mise en scène » dans le paysage théâtral français, Enjeux esthétiques, politiques et juridiques (1789-1914).
Inscrit au coeur de cette habilitation, cet ouvrage porte un éclairage sur le sens et les différentes expressions d’un art de la mise en scène dont l’historiographie actuelle situe la « naissance » avec l’ouverture du Théâtre-Libre d’André Antoine en 1887. Le terme « mise en scène » intègre pourtant le vocabulaire dramatique français aux lendemains de la Révolution de 1789 ; le « metteur en scène », occurrence déjà repérable dans le discours critique sous le Premier Empire, pénètre le personnel dramatique des théâtres dans les années 1825-30. En s’appuyant sur des sources à la fois littéraires, politiques et juridiques, cet essai a donc tenté d’identifier le sens et les enjeux d’une notion autour de laquelle se sont cristallisés les débats sur l’art théâtral jusqu’à nos jours.
Docteure en Esthétique, Sciences et Technologies des arts de l’Université Paris 8, Roxane Martin est actuellement maître de conférences en études théâtrales à l’Université de Nice-Sophia Antipolis et membre du CTEL. Spécialiste du théâtre français du XIXe siècle, elle est l’auteure de La Féerie romantique sur les scènes parisiennes, 1791-1864 (Champion, 2007, prix Georges-Jamati et prix de l’Académie française Roland de Jouvenel) et dirige actuellement l’édition critique du Théâtre complet de René-Charles Guilbert de Pixerécourt (Classiques-Garnier). Elle a aussi contribué à de nombreux ouvrages collectifs sur le théâtre de l’époque romantique.
Construire une histoire du théâtre français au XIXe siècle : l’analyse du spectaculaire comme méthode historiographique
Cette habilitation à diriger des recherches s’inscrit dans le cadre des préoccupations actuelles des historiens du théâtre. Depuis plusieurs années, des investigations d’envergure ont été menées, visant à réhabiliter des artistes et des répertoires longtemps oubliés. La réévaluation des outils et des méthodes de l’historiographie des spectacles a conduit à rendre compte des implications à la fois esthétiques, politiques et sociologiques d’un art scénique conçu comme pratique spectaculaire et culturelle au sens large.
Cette recherche abonde dans ce sens. L’élaboration d’une méthode d’analyse des oeuvres théâtrales du XIXe siècle français, fondée sur le croisement des documents conservés autour de leurs représentations (manuscrits de la censure et du souffleur, livrets de mise en scène, partitions d’orchestre, iconographies, maquettes de décors et de costumes…), a permis d’identifier la grammaire scénique de genres longtemps mésestimés par la critique littéraire. Féerie, vaudeville et mélodrame ne pouvaient plus, de la sorte, être dépréciés pour leur usage excessif des techniques de l’illusion, mais se posaient au contraire comme des formes qui avaient exploré la plasticité du langage et, par ce biais, conduit à affranchir l’écriture théâtrale des conventions académiques. Les relais entre parole, geste, son et image, une fois circonscrits, ont favorisé une lecture renouvelée du paysage théâtral de l’époque ; la prise en compte du spectaculaire et de la manière dont il a modelé l’écriture dramatique s’est offert comme un outil favorable pour construire une histoire du théâtre fondée sur la dimension scénique des oeuvres.
Cette méthode d’analyse a favorisé l’écriture d’un essai sur L’Émergence du concept de « mise en scène » dans le paysage théâtral français, Enjeux esthétiques, politiques et juridiques (1789-1914).
Inscrit au coeur de cette habilitation, cet ouvrage porte un éclairage sur le sens et les différentes expressions d’un art de la mise en scène dont l’historiographie actuelle situe la « naissance » avec l’ouverture du Théâtre-Libre d’André Antoine en 1887. Le terme « mise en scène » intègre pourtant le vocabulaire dramatique français aux lendemains de la Révolution de 1789 ; le « metteur en scène », occurrence déjà repérable dans le discours critique sous le Premier Empire, pénètre le personnel dramatique des théâtres dans les années 1825-30. En s’appuyant sur des sources à la fois littéraires, politiques et juridiques, cet essai a donc tenté d’identifier le sens et les enjeux d’une notion autour de laquelle se sont cristallisés les débats sur l’art théâtral jusqu’à nos jours.