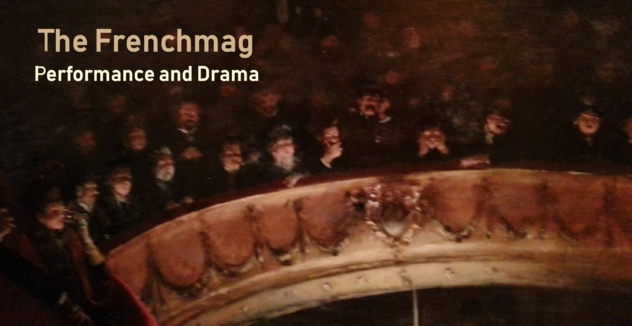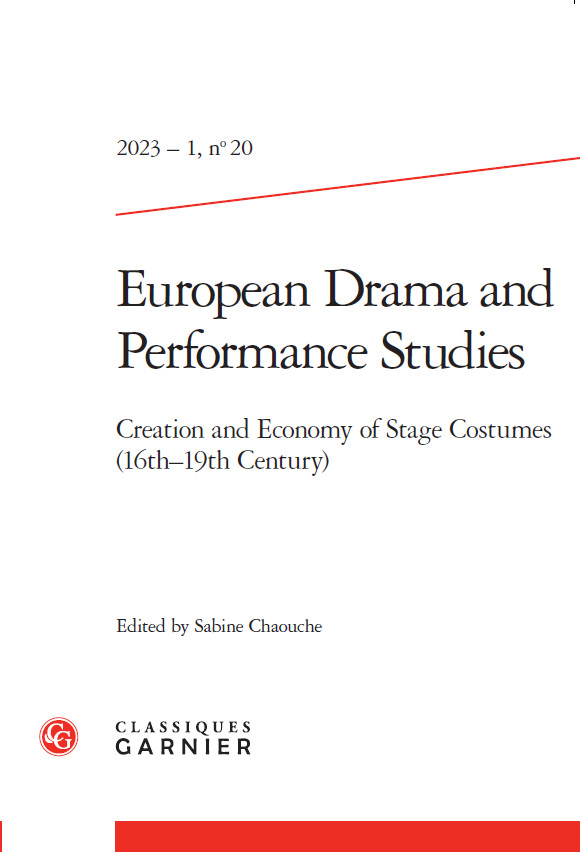Lorsqu'on pense au théâtre et au suicide, il est presque impossible de ne pas évoquer Jean Cocteau, auteur obsédé par l’omniprésence de la mort et par le suicide, sans doute comme inévitable renvoi au traumatisme vécu à neuf ans lorsqu’il retrouva le corps de son père qui s’était donné la mort dans sa chambre. Les pièces de Jean Cocteau qui affichent un personnage féminin qui met fin à ses jours plus comme glose de son amour excessif envers un autre être que par désespoir sont assez connues et nombreuses : nous pensons aux Parents terribles, L’Aigle à deux têtes, Les Enfants terribles et de manière exacerbée et orchestrée du début à la fin pour faire résonner à jamais le geste suicidaire de la protagoniste, à i[La Voix humaine].
La Voix humaine de Jean Cocteau est une pièce charpentée comme un monologue magistralement incarné par une femme qui, sur scène, joue ses derniers instants d’amante quittée et de manière icastique réalise l'acte final d'une mort aussi inattendue qu’inévitable. La voix de cette femme, demandée comme un emprunt à l’actrice Berthe Bovy – toute première interprète en 1930 et pour laquelle la pièce avait été expressément pensée –, a par la suite eu, entre autres, la voix de Jeanne Moreau, Anna Magnani, Anna Proclamer, Ingrid Bergman, Simone Signoret et dernièrement Sophia Loren pour une toute dernière version cinématographique en 2013. Bien que le désespoir de cette femme jouant son « solo de douleur » – comme la critique (1) a défini cette pièce – soit indéniable et que la pièce baigne dans une atmosphère de chagrin, le spectateur ne s’attend pas à un geste tragique final, du moins il ne le soupçonnera pas jusqu’à la moitié de l’œuvre. Il est vrai que cette femme déchirée par la trahison explique que, la veille, elle avait avalé douze comprimés de somnifère, « pour dormir sans rêve ». Mais son attachement à la communication téléphonique avec son ancien compagnon masque très bien son désir de répéter la tentative de suicide et elle affiche un tempérament tout autre que mortifère. Elle est en outre tout à fait atemporelle, l’icône du désespoir par amour. La protagoniste de ce monologue pourrait en effet être de n’importe quelle nation, n’importe quel âge et époque ; elle semble incarner à la perfection une pensée de Valéry qui pourrait bien faire office de légende à la pièce : « L’homme est adossé à sa mort comme le causeur à la cheminée » (2). Au fil des répliques, elle s’enfonce dans le drame qui sanctionne la rupture de sa liaison amoureuse et l’accompagne vers la mort.
Si, chez Cocteau, il y a des constantes, celles-ci concernent la poésie – étiquette sous laquelle il classait et déclinait toute sa production artistique –, et son rapport avec la mort, ainsi que l’un de ses corollaires, à savoir une relation inévitable et sous-jacente avec le suicide. Le père de l’auteur se tue dans son lit, marquant à jamais l’imaginaire du fils : les sèmes artistiques du sang, de la mort et du suicide seront la manière de cicatriser cette blessure enfantine profonde et choquante. Sa vie durant, Cocteau s’est présenté comme un poète, et dans presque tous ses ouvrages, l’antagoniste de cette fonction est la mort. Il suffit de penser à son premier film, Le Sang d’un poète, à la pièce Le Poète et sa mort, à Orphée ou au Testament d’Orphée.
Les textes de Cocteau passent en revue plusieurs éléments qui font partie de la rhétorique du suicide et de la pathologie du malade psychiatrique : la peur que la mort arrive trop tard, l'angoisse de devoir se donner la mort seul(e) dans une chambre, la culpabilité envers l’être aimé et enfin la décision abrupte et non édulcorée de couper court à tout.
Toute sa production semble être une de l’expérience suicidaire et une manière de flirter avec la mort, ce qui est bien présent dans La Voix humaine. La mise en scène est construite sur un équilibre très délicat, cherché entre la volonté de dépouillement d’une pièce-boîte et la surenchère de mots et de pathos, sans pourtant afficher des pleurnicheries excessives ni des exagérations ou de faux intellectualismes. D’ailleurs à ce propos Cocteau avait donné des indications très précises qui font encore autorité : « derrière son jeu [de l’actrice] l’œuvre s’effacerait, le drame donnant l’occasion de jouer deux rôles, un lorsque l’actrice parle, un autre lorsqu’elle écoute et délimite le caractère du personnage invisible qui s’exprime par ses silences » (3). C’est sans doute aussi grâce à cette simplicité qu’il s’agit d’une pièce d’une grande longévité, parmi les plus représentées et adaptées.
Nous désirons par cette brève étude analyser avec quel accessoire Cocteau laisse cette femme se donner la mort et, parallèlement, faire des incursions dans les stratégies rhétoriques qui caractérisent le monologue de cette voix, dans le titre toujours signalée par la majuscule pour en souligner l’importance concrète, une voix qui flirte avec le silence autant que la femme le fait avec l’absence de son ancien amoureux. Nous désirons notamment souligner par quelle stratégie cette femme minimise la trahison de son amant, selon quelle forme rhétorique elle lui pardonne toute faute et en mitige chaque geste.
Une attention toute particulière sera en outre portée à cette voix qui est la seule et véritable protagoniste : est-elle un véritable personnage ou plus simplement un instrument puisqu’il est le seul moyen pour les deux amants d’arriver l’un à l’autre pour ensuite se taire à jamais ? D’après la plupart des critiques examinant ce texte, la pièce a été écrite non dans la langue mais dans la voix en spécifiant que
b[cette pièce en un acte est fondamentalement une pièce d’acteur, long monologue […] qui exige de son unique interprète une performance de premier ordre. Cocteau offre un solo de douleur qui ne manque pas d’assouvir un désir qui l’accompagne sa vie d’artiste durant, montrer la connexion intime entre l’amour et la mort]b. (4)
François Truffaut, voyant Anna Magnani jouer cette pièce dans la version cinématographique réalisée par Roberto Rossellini en 1947, la définira non seulement comme un monologue magistral, mais aussi « un jeu phénoménologique », ce qui rejoint le commentaire de Roberto Rossellini, lui-même, d’après lequel jouer La Voix humaine signifiait mettre en scène l'anatomie d'un sentiment, la vision au microscope de la souffrance d'un visage, d'une vie, résumée en une voix. En effet cette pièce sera jouée à la radio par beaucoup d’interprètes, y compris Simone Signoret, et c’est la voix qui importe, qui prend un espace, une forme, qui joue en donnant lieu même au silence lorsqu’il faut deviner les répliques de l’amant, ou qui se transforme en chant dans les nombreuses adaptations faites pour l’opéra à partir de la plus magistrale de toutes les adaptations lyriques, celle de Francis Poulenc (dont nous traiterons très brièvement un peu plus loin).
Nous nous proposons en effet de nous limiter à la version théâtrale et d’analyser les deux « objets » indispensables à cette mise en scène : le téléphone et la couleur. À ce propos, pas de doute, la couleur dominante était unique, le blanc, qui aurait dû, de manière absolue, non seulement effacer tout point de repère mais aussi se prêter à une nouvelle plasticité : blanc comme la couleur du deuil en Orient, blanc comme l’élimination de toute tache. Si la symbolique du blanc n’a pas été respectée et saisie par tous les metteurs en scène de cette pièce, – en dénaturant parfois beaucoup l’esthétique de Cocteau par un simple changement de ton chromatique –, le téléphone reste un essentiel à toutes les représentations. Une autre certitude pour les spectateurs qui vont voir cette pièce est le soin que chaque metteur en scène aurait apporté au choix d’une actrice au tempérament très fort, choix crucial qui s’impose à chaque version proposée, laquelle ne peut miser que sur l’interprète et ses ressources artistiques pour donner du souffle à cet engageant « one-woman-show ». La pièce n’a d’existence possible que dans les cordes vocales et la fibre artistique de son interprète.
La Voix humaine de Jean Cocteau est une pièce charpentée comme un monologue magistralement incarné par une femme qui, sur scène, joue ses derniers instants d’amante quittée et de manière icastique réalise l'acte final d'une mort aussi inattendue qu’inévitable. La voix de cette femme, demandée comme un emprunt à l’actrice Berthe Bovy – toute première interprète en 1930 et pour laquelle la pièce avait été expressément pensée –, a par la suite eu, entre autres, la voix de Jeanne Moreau, Anna Magnani, Anna Proclamer, Ingrid Bergman, Simone Signoret et dernièrement Sophia Loren pour une toute dernière version cinématographique en 2013. Bien que le désespoir de cette femme jouant son « solo de douleur » – comme la critique (1) a défini cette pièce – soit indéniable et que la pièce baigne dans une atmosphère de chagrin, le spectateur ne s’attend pas à un geste tragique final, du moins il ne le soupçonnera pas jusqu’à la moitié de l’œuvre. Il est vrai que cette femme déchirée par la trahison explique que, la veille, elle avait avalé douze comprimés de somnifère, « pour dormir sans rêve ». Mais son attachement à la communication téléphonique avec son ancien compagnon masque très bien son désir de répéter la tentative de suicide et elle affiche un tempérament tout autre que mortifère. Elle est en outre tout à fait atemporelle, l’icône du désespoir par amour. La protagoniste de ce monologue pourrait en effet être de n’importe quelle nation, n’importe quel âge et époque ; elle semble incarner à la perfection une pensée de Valéry qui pourrait bien faire office de légende à la pièce : « L’homme est adossé à sa mort comme le causeur à la cheminée » (2). Au fil des répliques, elle s’enfonce dans le drame qui sanctionne la rupture de sa liaison amoureuse et l’accompagne vers la mort.
Si, chez Cocteau, il y a des constantes, celles-ci concernent la poésie – étiquette sous laquelle il classait et déclinait toute sa production artistique –, et son rapport avec la mort, ainsi que l’un de ses corollaires, à savoir une relation inévitable et sous-jacente avec le suicide. Le père de l’auteur se tue dans son lit, marquant à jamais l’imaginaire du fils : les sèmes artistiques du sang, de la mort et du suicide seront la manière de cicatriser cette blessure enfantine profonde et choquante. Sa vie durant, Cocteau s’est présenté comme un poète, et dans presque tous ses ouvrages, l’antagoniste de cette fonction est la mort. Il suffit de penser à son premier film, Le Sang d’un poète, à la pièce Le Poète et sa mort, à Orphée ou au Testament d’Orphée.
Les textes de Cocteau passent en revue plusieurs éléments qui font partie de la rhétorique du suicide et de la pathologie du malade psychiatrique : la peur que la mort arrive trop tard, l'angoisse de devoir se donner la mort seul(e) dans une chambre, la culpabilité envers l’être aimé et enfin la décision abrupte et non édulcorée de couper court à tout.
Toute sa production semble être une de l’expérience suicidaire et une manière de flirter avec la mort, ce qui est bien présent dans La Voix humaine. La mise en scène est construite sur un équilibre très délicat, cherché entre la volonté de dépouillement d’une pièce-boîte et la surenchère de mots et de pathos, sans pourtant afficher des pleurnicheries excessives ni des exagérations ou de faux intellectualismes. D’ailleurs à ce propos Cocteau avait donné des indications très précises qui font encore autorité : « derrière son jeu [de l’actrice] l’œuvre s’effacerait, le drame donnant l’occasion de jouer deux rôles, un lorsque l’actrice parle, un autre lorsqu’elle écoute et délimite le caractère du personnage invisible qui s’exprime par ses silences » (3). C’est sans doute aussi grâce à cette simplicité qu’il s’agit d’une pièce d’une grande longévité, parmi les plus représentées et adaptées.
Nous désirons par cette brève étude analyser avec quel accessoire Cocteau laisse cette femme se donner la mort et, parallèlement, faire des incursions dans les stratégies rhétoriques qui caractérisent le monologue de cette voix, dans le titre toujours signalée par la majuscule pour en souligner l’importance concrète, une voix qui flirte avec le silence autant que la femme le fait avec l’absence de son ancien amoureux. Nous désirons notamment souligner par quelle stratégie cette femme minimise la trahison de son amant, selon quelle forme rhétorique elle lui pardonne toute faute et en mitige chaque geste.
Une attention toute particulière sera en outre portée à cette voix qui est la seule et véritable protagoniste : est-elle un véritable personnage ou plus simplement un instrument puisqu’il est le seul moyen pour les deux amants d’arriver l’un à l’autre pour ensuite se taire à jamais ? D’après la plupart des critiques examinant ce texte, la pièce a été écrite non dans la langue mais dans la voix en spécifiant que
b[cette pièce en un acte est fondamentalement une pièce d’acteur, long monologue […] qui exige de son unique interprète une performance de premier ordre. Cocteau offre un solo de douleur qui ne manque pas d’assouvir un désir qui l’accompagne sa vie d’artiste durant, montrer la connexion intime entre l’amour et la mort]b. (4)
François Truffaut, voyant Anna Magnani jouer cette pièce dans la version cinématographique réalisée par Roberto Rossellini en 1947, la définira non seulement comme un monologue magistral, mais aussi « un jeu phénoménologique », ce qui rejoint le commentaire de Roberto Rossellini, lui-même, d’après lequel jouer La Voix humaine signifiait mettre en scène l'anatomie d'un sentiment, la vision au microscope de la souffrance d'un visage, d'une vie, résumée en une voix. En effet cette pièce sera jouée à la radio par beaucoup d’interprètes, y compris Simone Signoret, et c’est la voix qui importe, qui prend un espace, une forme, qui joue en donnant lieu même au silence lorsqu’il faut deviner les répliques de l’amant, ou qui se transforme en chant dans les nombreuses adaptations faites pour l’opéra à partir de la plus magistrale de toutes les adaptations lyriques, celle de Francis Poulenc (dont nous traiterons très brièvement un peu plus loin).
Nous nous proposons en effet de nous limiter à la version théâtrale et d’analyser les deux « objets » indispensables à cette mise en scène : le téléphone et la couleur. À ce propos, pas de doute, la couleur dominante était unique, le blanc, qui aurait dû, de manière absolue, non seulement effacer tout point de repère mais aussi se prêter à une nouvelle plasticité : blanc comme la couleur du deuil en Orient, blanc comme l’élimination de toute tache. Si la symbolique du blanc n’a pas été respectée et saisie par tous les metteurs en scène de cette pièce, – en dénaturant parfois beaucoup l’esthétique de Cocteau par un simple changement de ton chromatique –, le téléphone reste un essentiel à toutes les représentations. Une autre certitude pour les spectateurs qui vont voir cette pièce est le soin que chaque metteur en scène aurait apporté au choix d’une actrice au tempérament très fort, choix crucial qui s’impose à chaque version proposée, laquelle ne peut miser que sur l’interprète et ses ressources artistiques pour donner du souffle à cet engageant « one-woman-show ». La pièce n’a d’existence possible que dans les cordes vocales et la fibre artistique de son interprète.
Une lecture orientée
Comme Cocteau en avait l’habitude, il accompagne La Voix humaine de plusieurs déclarations et indications de mise en scène qui ne laissent aucun doute quant à l’importance de l’essentialité du décor et à sa sobriété, et elles sont indispensables pour tout miser sur le matériel émotionnel et « humain », sur la performance de l’actrice. Cocteau était fidèle à trois impératifs lorsqu’il était question de théâtre : renouveler les codes et le langage théâtral, éviter que le public se laisse aller à une lecture naturaliste et, enfin, donner la primauté à la théâtralité. Une lecture qui devait éviter toute mise en scène somptueuse, pictorialiste, exagérée ou caricaturale. Cela est d’autant plus évident si on considère que Cocteau voyait dans cette pièce une rupture avec ses œuvres théâtrales précédentes, des œuvres où la mise en scène l’avait emporté. Il renonce à l’orchestre, il met en scène un dispositif théâtral épuré de tout décor et il décide que la voix sera la seule matière plastique, une voix qui est protagoniste et co-protagoniste. Or, pour mieux dire, ce qui est co-protagoniste est l’absent, l’amant traître, ce rôle que l’on doit deviner et reformuler de manière imaginaire à partir des répliques de la femme délaissée et le fil du raisonnement, en le déduisant des réactions de l’actrice qui ne fait ainsi que jouer avec le vide, sa voix dialoguant avec le silence de l’interlocuteur désormais seulement imaginé.
Les didascalies de l'auteur offrent une lecture très explicite de la mise en scène dépouillée : une seule pièce, pas de décor sinon des rideaux blancs tout aussi angoissants que la nuisette de l'actrice, qui fait comme si elle était nue, innocente et désarmée face au public. L’objet esthétique qui doit émerger de toute cette pureté est le principe de privation (5) qui en quelque sorte anticipe le dénouement fatal et accompagne la femme vers sa mort. C’est une pièce de l’absence, une pièce où la figure invisible de l’amant qui est en train de sortir de la vie de la protagoniste monologuant, prend corps seulement grâce à la voix de cette même femme, qui ainsi donne vie et se désigne comme le signe de vie de deux existences. Une véritable épreuve de la maîtrise rhétorique de l’auteur qui doit laisser filtrer le silence et les pauses ainsi que doser les répétitions et les reprises pour transformer constamment le monologue en un duo entre un invisible et une suicidaire.
Lorsqu’il était enfant et fréquentait le théâtre avec ses parents, Cocteau avait été profondément fasciné par les grands drames du théâtre classique. Des pièces souvent réussies simplement grâce au charisme des acteurs et il aurait envisagé un retour au « naturel des planches » (6), loin de l’exigence des décors excentriques auxquels lui aussi s’était plié parfois dans le cas de certaines œuvres pour conquérir le grand public. Avec La Voix humaine, tout comme avec Les Parents terribles, pièce écrite presque dix ans après et s’achevant, elle-aussi, par la mort d’une femme amoureuse, Yvonne, mère jalouse de son fils Michel, Cocteau veut que le drame surgisse des mots, du texte et que ce dernier soit éclairé par l’interprétations des acteurs, sans surcharge. S’il définit Les Parents terribles comme « une pièce nue »(7), nous pouvons qualifier La Voix humaine de pièce blanche, là où cette couleur souligne l’élimination, l’effacement l’absolu que la protagoniste veut opérer par son geste final. Une couleur qui a déjà été chez l’auteur le prélude et le signe distinctif de la mort : dans Le Jeune Homme et la mort, mimodrame d’intensité et de succès incontestables où le ballet et les gestes soulignent chaque émotion mieux que des mots, la mort arrive habillée en blanc, candide et surprenante comme une épouse.
Les indications pour mettre en scène le dialogue monologué(8) de La Voix ne viennent pas seulement de Jean Cocteau : la version lyrique créée par Francis Poulenc en accumule également beaucoup et contribue ainsi à construire la tradition de la pièce. Poulenc décide de donner corps à une tragédie lyrique pour la chanteuse Denise Duval presque trente ans après la première représentation sur scène du texte et, pour le livret, collabore avec Cocteau. Poulenc se concentre notamment sur la voix de la chanteuse, une voix qui doit amener sur scène une femme encore jeune, puisque cette pièce ne raconte pas le drame d’une vieille femme quittée. Il mise également sur le pathos que l’orchestre, ponctuellement devra engendrer, en soulignant les gestes de cet être, en concrétisant les répliques de l’amant qui noircissent la douleur ou les petits bonheurs relevant des souvenirs du passé.
De son côté Cocteau est bien clair : l’élément le plus fort doit être la performance de l’actrice jouant tous les rôles, façonnant par ses silences les répliques imaginées de son amant selon le pouvoir et la magie du théâtre, sans psychologie ni critique littéraire, exigeant exclusivement du théâtre pur. Pour ce faire « il importait donc d’aller au plus simple »(9). Cocteau est très précis à cet égard :
La scène, réduite, représente l'angle d'une chambre de femme, chambre sombre, bleuâtre, avec, à gauche, un lit en désordre, et, à droite, une porte ouverte sur la salle de bains blanche, très éclairée. (10)
C’est une pièce, ajoutons-nous, de la contrainte, où la nudité du décor attire davantage l’attention sur la complexité de la douleur. Ce qui relève aussi de la fréquentation cocteauienne (11) du cinéma, habitué aux voix off et au rapport dialogique entre mots, image et voix hors champ et qui ici doit garder un niveau de pathos constant, voire en crescendo, jusqu’à ce que l’amant invisible soit de plus en plus présent au fur et à mesure que le désespoir de la femme augmente.
La lumière aussi doit être maniée avec finesse. L’auteur à ce propos se voudrait plasticien du noir et blanc et spécifie qu’il fallait « Trouver un éclairage du trou du souffleur qui forme une ombre haute derrière la femme assise et souligne l’éclairage de l’abat-jour » (12). De manière analogue il avait voulu organiser la scène des Parents terribles en réduisant au strict minimum « les subterfuges décoratifs »(13) pour accentuer le caractère absolu de chaque personnage et faire en sorte que la rigueur du drame captive les spectateurs par sa netteté et non pas par un luxe encombrant. Une rigueur cruelle qui est accentuée par les indications concernant la lumière : « Les fenêtres sont censées ouvertes dans le mur idéal. Il en arrive une lumière sinistre : celle de l’immeuble d’en face. Pénombre »(14). Comme si la société, ses regards et ses jugement portés sur l’histoire pouvaient se résumer dans cette ombre portée sur l’hôtel où se joue le drame des Parents terribles.
Dans une interview de 1959 au Monde, comme le rappelle Marie Anne Guérin, Cocteau s’exprime à propos de la relation entre le scénario de ses films et les pensées qu’il veut véhiculer :
Je profite du réalisme des lieux, de personnes, de gestes, de paroles, de la musique, pour procurer à l’abstraction de la pensée un moule et, dirais-je, pour construire un château sans lequel on imagine mal un fantôme. (15)
Dans La Voix humaine, le procédé semble bien être l’inverse : créer par l’essentialité, toucher aussi l’abstrait et le symbolique, en créant par très peu de traits scéniques la toile de fond d’un délire-confession amoureuse qui accompagne le suicide, une longue digression mortelle qui est analysée, décomposée, morcelée sur scène. La voix ne devra pas être mêlée à trop d’objets, la femme ne portera qu’un peignoir-chemise blanc ; la même candeur devant caractériser l’abat-jour, les housses, le fauteuil-chaise et la salle de bain qui se devinerait d’une porte entre-ouverte (16). La pureté de ce choix presque virginal et obsédant qui, d’après la volonté de Cocteau, est un trait nécessaire pour situer le drame dans l’indéfini et est à retrouver dans tout accessoire, dans tout élément, est contredite seulement par le désordre de la pièce. Le lit défait ainsi que les objets éparpillés doivent suggérer le malaise de la femme traînant dans une atmosphère d’inquiétude, de perte du contrôle, qui s’apprête à accueillir la tragédie et que Cocteau n’hésite pas à designer de manière tragique et sans doute autobiographique comme une « chambre de meurtre » (17).
Les didascalies de l'auteur offrent une lecture très explicite de la mise en scène dépouillée : une seule pièce, pas de décor sinon des rideaux blancs tout aussi angoissants que la nuisette de l'actrice, qui fait comme si elle était nue, innocente et désarmée face au public. L’objet esthétique qui doit émerger de toute cette pureté est le principe de privation (5) qui en quelque sorte anticipe le dénouement fatal et accompagne la femme vers sa mort. C’est une pièce de l’absence, une pièce où la figure invisible de l’amant qui est en train de sortir de la vie de la protagoniste monologuant, prend corps seulement grâce à la voix de cette même femme, qui ainsi donne vie et se désigne comme le signe de vie de deux existences. Une véritable épreuve de la maîtrise rhétorique de l’auteur qui doit laisser filtrer le silence et les pauses ainsi que doser les répétitions et les reprises pour transformer constamment le monologue en un duo entre un invisible et une suicidaire.
Lorsqu’il était enfant et fréquentait le théâtre avec ses parents, Cocteau avait été profondément fasciné par les grands drames du théâtre classique. Des pièces souvent réussies simplement grâce au charisme des acteurs et il aurait envisagé un retour au « naturel des planches » (6), loin de l’exigence des décors excentriques auxquels lui aussi s’était plié parfois dans le cas de certaines œuvres pour conquérir le grand public. Avec La Voix humaine, tout comme avec Les Parents terribles, pièce écrite presque dix ans après et s’achevant, elle-aussi, par la mort d’une femme amoureuse, Yvonne, mère jalouse de son fils Michel, Cocteau veut que le drame surgisse des mots, du texte et que ce dernier soit éclairé par l’interprétations des acteurs, sans surcharge. S’il définit Les Parents terribles comme « une pièce nue »(7), nous pouvons qualifier La Voix humaine de pièce blanche, là où cette couleur souligne l’élimination, l’effacement l’absolu que la protagoniste veut opérer par son geste final. Une couleur qui a déjà été chez l’auteur le prélude et le signe distinctif de la mort : dans Le Jeune Homme et la mort, mimodrame d’intensité et de succès incontestables où le ballet et les gestes soulignent chaque émotion mieux que des mots, la mort arrive habillée en blanc, candide et surprenante comme une épouse.
Les indications pour mettre en scène le dialogue monologué(8) de La Voix ne viennent pas seulement de Jean Cocteau : la version lyrique créée par Francis Poulenc en accumule également beaucoup et contribue ainsi à construire la tradition de la pièce. Poulenc décide de donner corps à une tragédie lyrique pour la chanteuse Denise Duval presque trente ans après la première représentation sur scène du texte et, pour le livret, collabore avec Cocteau. Poulenc se concentre notamment sur la voix de la chanteuse, une voix qui doit amener sur scène une femme encore jeune, puisque cette pièce ne raconte pas le drame d’une vieille femme quittée. Il mise également sur le pathos que l’orchestre, ponctuellement devra engendrer, en soulignant les gestes de cet être, en concrétisant les répliques de l’amant qui noircissent la douleur ou les petits bonheurs relevant des souvenirs du passé.
De son côté Cocteau est bien clair : l’élément le plus fort doit être la performance de l’actrice jouant tous les rôles, façonnant par ses silences les répliques imaginées de son amant selon le pouvoir et la magie du théâtre, sans psychologie ni critique littéraire, exigeant exclusivement du théâtre pur. Pour ce faire « il importait donc d’aller au plus simple »(9). Cocteau est très précis à cet égard :
La scène, réduite, représente l'angle d'une chambre de femme, chambre sombre, bleuâtre, avec, à gauche, un lit en désordre, et, à droite, une porte ouverte sur la salle de bains blanche, très éclairée. (10)
C’est une pièce, ajoutons-nous, de la contrainte, où la nudité du décor attire davantage l’attention sur la complexité de la douleur. Ce qui relève aussi de la fréquentation cocteauienne (11) du cinéma, habitué aux voix off et au rapport dialogique entre mots, image et voix hors champ et qui ici doit garder un niveau de pathos constant, voire en crescendo, jusqu’à ce que l’amant invisible soit de plus en plus présent au fur et à mesure que le désespoir de la femme augmente.
La lumière aussi doit être maniée avec finesse. L’auteur à ce propos se voudrait plasticien du noir et blanc et spécifie qu’il fallait « Trouver un éclairage du trou du souffleur qui forme une ombre haute derrière la femme assise et souligne l’éclairage de l’abat-jour » (12). De manière analogue il avait voulu organiser la scène des Parents terribles en réduisant au strict minimum « les subterfuges décoratifs »(13) pour accentuer le caractère absolu de chaque personnage et faire en sorte que la rigueur du drame captive les spectateurs par sa netteté et non pas par un luxe encombrant. Une rigueur cruelle qui est accentuée par les indications concernant la lumière : « Les fenêtres sont censées ouvertes dans le mur idéal. Il en arrive une lumière sinistre : celle de l’immeuble d’en face. Pénombre »(14). Comme si la société, ses regards et ses jugement portés sur l’histoire pouvaient se résumer dans cette ombre portée sur l’hôtel où se joue le drame des Parents terribles.
Dans une interview de 1959 au Monde, comme le rappelle Marie Anne Guérin, Cocteau s’exprime à propos de la relation entre le scénario de ses films et les pensées qu’il veut véhiculer :
Je profite du réalisme des lieux, de personnes, de gestes, de paroles, de la musique, pour procurer à l’abstraction de la pensée un moule et, dirais-je, pour construire un château sans lequel on imagine mal un fantôme. (15)
Dans La Voix humaine, le procédé semble bien être l’inverse : créer par l’essentialité, toucher aussi l’abstrait et le symbolique, en créant par très peu de traits scéniques la toile de fond d’un délire-confession amoureuse qui accompagne le suicide, une longue digression mortelle qui est analysée, décomposée, morcelée sur scène. La voix ne devra pas être mêlée à trop d’objets, la femme ne portera qu’un peignoir-chemise blanc ; la même candeur devant caractériser l’abat-jour, les housses, le fauteuil-chaise et la salle de bain qui se devinerait d’une porte entre-ouverte (16). La pureté de ce choix presque virginal et obsédant qui, d’après la volonté de Cocteau, est un trait nécessaire pour situer le drame dans l’indéfini et est à retrouver dans tout accessoire, dans tout élément, est contredite seulement par le désordre de la pièce. Le lit défait ainsi que les objets éparpillés doivent suggérer le malaise de la femme traînant dans une atmosphère d’inquiétude, de perte du contrôle, qui s’apprête à accueillir la tragédie et que Cocteau n’hésite pas à designer de manière tragique et sans doute autobiographique comme une « chambre de meurtre » (17).
L’objet indispensable : le téléphone
Les mots tuent, l’absence de mots aussi.
Gibert Cesbron, Journal sans date, Paris, Laffont, 1963
Dans la préface à la pièce, les indications scéniques de Cocteau qualifient sans trop d’implicite le statut du téléphone qui, dès le début, est décrit de la sorte : « l’accessoire banal des pièces modernes, le téléphone » (18).
L'amante désespérée s’accroche avec ses doigts à ce téléphone qui sera l’autre protagoniste sur scène ainsi que le stratagème pour faire vivre, pendant quarante-cinq minutes, l’écho de la fin d’un amour, une fin qui entraînera celle d’une vie. C’est un objet à serrer, à garder dans le lit, comme la dernière trace concrète de l’homme aimé, la seule possibilité matérielle d’entendre encore des mots consolateurs, dans le berceau mortel de sa chambre-boîte, en mythifiant le coup de fil promis comme le dernier cadeau dû par l’amant qui l’a quittée. Elle l’attend comme si c’était la dernière cigarette du condamné, son dernier souvenir de plaisir. Malgré les interférences, les coupures et les innombrables et grotesques dérangements de la ligne, elle serait capable de s’apercevoir du moindre signe d’amour restant dans la voix à l’autre bout de ses doigts. Elle guette une parole de salut, une déclaration-aveu, se contenterait même d’un mensonge pour se soulager, un mensonge qui n’arrivera pas. Ce n’est que le téléphone qui peut la relier une dernière fois à l’homme si désespérément aimé. Cette tragédie lyrique ne doit pas se jouer sur la vision ou en s’appuyant sur le spectaculaire : c’est le téléphone, et non pas une photo, ni un portrait ou un autre objet, qui se charge du poids du sens de la fin d’une vie et souligne la solitude de cet être qui se retire de la scène de sa vie. La pièce est en tout cas une œuvre très peu visuelle : mettre en scène le préambule d’un suicide de manière sobre et essentielle est la seule audace qui se permet Cocteau, le reste doit se passer dans la simplicité des émotions et des symboles, sans subterfuges, par la voix, à elle seule. Est laissée à la capacité stylistique de Cocteau la tâche de faire deviner les mots de l’amant à l’autre bout de la communication, et à l’intensité de l’interprète la responsabilité de leur donner un véritable corps sonore, lors de cette tentative de conversation qui est constamment dérangée. C’est ainsi que l’on montre le drame de tout couple en train de se quitter : la difficulté de se comprendre, l’impossibilité de voir réellement l’autre et de laisser s’évanouir, voire déchirer, la construction idéale qu’on avait alimentée. Cocteau semble également mettre en avant comment, dans des conditions normales de communication, le téléphone envahit nos vies et comment, ainsi que l’expliquera par la suite Marshall Macluhan, cet outil « contrairement à l’écriture, et à l’imprimé, impose une participation totale »(19). Une participation qu’Anna Magnani interprétant ce rôle, comme une autre actrice italienne remarquable telle que Anna Proclamer dirigée par Giorgio Strehler, arrivent à porter sur scène grâce à leur incontestable présence scénique.
Le téléphone représente ainsi le pouvoir affabulateur des mots et la manière d’accéder à ce pouvoir pour en être le maître ou l’esclave. Mais il témoigne également les progrès médiatiques et le rêve tout humain d’arriver toujours plus loin, même dans les sentiments des autres personnes, grâce à des outils, ce qui relève d’une illusion, d’une utopie si on pense au dénouement choisi par Cocteau. Effacer techniquement les distances à travers le téléphone ne permet pas à la protagoniste d’atteindre avec son discours le cœur de son aimé. Cet outil ne peut pas se rendre autonome et prendre la place de l’amant : il est montré pour sa nature fragile, insuffisante, incapable de remplacer un véritable échange face à face. Cette femme sur le seuil de la mort est bien consciente des limites du medium mais aussi de son terrible potentiel et elle le souligne de manière manifeste lorsqu’elle dit : « Si tu ne m’aimais pas et si tu étais adroit, le téléphone deviendrait une arme effrayante, une arme qui ne laisse pas de traces, ne fait pas de bruit » (20). Une arme que l’on charge tous les jours et qui fait partie de notre arsenal domestique et identitaire : le téléphone comme un pistolet et les mots comme des balles aussi banales et ternies par l’usage que mortelles. Cocteau connait bien le pouvoir de ces munitions et il les pèse, il les choisit ou il les répète comme il le faisait dans certains de ses poèmes où la parole se répand, comme semée loin, déstructurée et pourtant significative. Dans son recueil Géorgiques funèbres par exemple, les versiculets à un seul mot soulignent une conception moderne de l’espace ; les vers se désarticulent et s’effilochent dans un univers abrupt qui s’écroule. Nous pensons que de manière analogue cette pièce accompagne la suicidée vers un gouffre, en accélérant son geste au fur et à mesure que ses mots se font mimésis d’une répétition obsédante ainsi que de l’asphyxie finale. On ne doit retenir que l’essentiel : en s’approchant de la fin de la pièce, les occurrences les plus fréquentes sont toutes afférentes au champ sémantique du mensonge. Cocteau cite l’illusion, l’imagination, le hasard et l’acte de mentir « par bonté » (21). Les mots de la vérité dont elle ne peut se passer ne sont pas toujours désintéressés et, parallèlement, les mensonges ne sont pas toujours un acte à reprocher. Le téléphone devrait encourager cette attitude de fausseté, de dissimulation et permettre de faire souffrir un peu moins cette amante trahie qui rêve d’un dernier signe d’attention passionné. Toutefois, ce mensonge ne sera pas prononcé et cette communication ne sera pas facile : dès le début un syntagme très rapide semble se faire métaphoriquement le commentaire synthétique du drame qui se joue dans l’âme de cette femme. Nous nous référons à la réplique du tout début de la conversation : « C’était un vrai supplice de t’entendre à travers tout ce monde » (22). Voici le sens de son geste funeste : la nécessité atroce d’apprendre à regarder son compagnon comme n’importe quelle autre personne, l’obligation de devenir pour lui une simple composante de ce « tout le monde », perdre son filtre privilégié de maîtresse. Ne plus pouvoir « entendre » est aussi métaphorique de la perte totale d’esprit, d’entendement, et le substantif supplice glose l’attitude de la femme sur scène.
Ainsi le téléphone, cet objet désormais si indispensable dans notre époque s’affichait déjà, il y a presque cent ans, à la fois comme un lien capable de réduire les écarts et comme une arme qui, bien utilisée, aurait pu sauver tout comme véhiculer le verdict : un instrument qui permet à l’actrice de construire son désespoir et ses moments fugaces de consolation. Autant que les mots, véritables pistolets dans nos mains, le téléphone aussi est une arme blanche mortelle, qui semble la secouer par de véritables coups à chaque fois que la communication est interrompue.
La femme déchirée, au sujet du fil du téléphone dira que « c’est le dernier qui me rattache encore à nous » (23), ce qui rappelle comment la distance annulée autrefois par le téléphone et aujourd'hui par des écrans ne peut pourtant soigner une âme qui se sent seule, qui ne rencontre qu’une bouche virtuelle muette confirmant sa solitude. En ce sens, Cocteau est pionnier dans l'attribution aux médias d'un rôle d'intermédiaire dans un rapport amoureux, un medium qui, dans ce cas, accompagne vers l’épilogue tragique. La voix de la femme, non son visage, que l'on voit pleurer, crier et gémir, affirme : « mais j’avais le téléphone dans mon lit et malgré tout, on est relié par téléphone... Parce que tu me parles »... comme si le téléphone avait pu, en objet miraculeux et fétiche, manifester ce qui était autrefois l’haleine divine de l’être aimé, la voix filtrant par le récepteur comme celle écoutée en posant son oreille (24) sur la poitrine de l’homme. D’après Claude Burgelin, cette femme reconnaît non seulement sa dépendance amoureuse mais aussi l’impossibilité de se séparer du téléphone (25) et c’est exclusivement au moment où elle réalise l’insuffisance de ce dernier, qu’elle décide de le faire disparaitre avec elle : il devient inutile puisque il ne lui ramènera pas l’objet de son amour. Et en prononçant ses derniers mots, les derniers de la pièce, elle n’attend même plus le temps d’entendre les réponses de son amant. Ce dernier, d’ailleurs, n’est plus son aimé : il est devenu, au fil des heures, un simple interlocuteur et cela lui est insupportable.
Ainsi fige-t-elle le moment de l’abandon en essayant de l’effacer par la répétition machinale du dernier mot de la pièce qui devrait symboliquement bloquer tout changement, affichant comme la seule vérité éternelle son « je t’aime », qui doit rester comme le seul souvenir pour l’amant et pour le spectateur.
Gibert Cesbron, Journal sans date, Paris, Laffont, 1963
Dans la préface à la pièce, les indications scéniques de Cocteau qualifient sans trop d’implicite le statut du téléphone qui, dès le début, est décrit de la sorte : « l’accessoire banal des pièces modernes, le téléphone » (18).
L'amante désespérée s’accroche avec ses doigts à ce téléphone qui sera l’autre protagoniste sur scène ainsi que le stratagème pour faire vivre, pendant quarante-cinq minutes, l’écho de la fin d’un amour, une fin qui entraînera celle d’une vie. C’est un objet à serrer, à garder dans le lit, comme la dernière trace concrète de l’homme aimé, la seule possibilité matérielle d’entendre encore des mots consolateurs, dans le berceau mortel de sa chambre-boîte, en mythifiant le coup de fil promis comme le dernier cadeau dû par l’amant qui l’a quittée. Elle l’attend comme si c’était la dernière cigarette du condamné, son dernier souvenir de plaisir. Malgré les interférences, les coupures et les innombrables et grotesques dérangements de la ligne, elle serait capable de s’apercevoir du moindre signe d’amour restant dans la voix à l’autre bout de ses doigts. Elle guette une parole de salut, une déclaration-aveu, se contenterait même d’un mensonge pour se soulager, un mensonge qui n’arrivera pas. Ce n’est que le téléphone qui peut la relier une dernière fois à l’homme si désespérément aimé. Cette tragédie lyrique ne doit pas se jouer sur la vision ou en s’appuyant sur le spectaculaire : c’est le téléphone, et non pas une photo, ni un portrait ou un autre objet, qui se charge du poids du sens de la fin d’une vie et souligne la solitude de cet être qui se retire de la scène de sa vie. La pièce est en tout cas une œuvre très peu visuelle : mettre en scène le préambule d’un suicide de manière sobre et essentielle est la seule audace qui se permet Cocteau, le reste doit se passer dans la simplicité des émotions et des symboles, sans subterfuges, par la voix, à elle seule. Est laissée à la capacité stylistique de Cocteau la tâche de faire deviner les mots de l’amant à l’autre bout de la communication, et à l’intensité de l’interprète la responsabilité de leur donner un véritable corps sonore, lors de cette tentative de conversation qui est constamment dérangée. C’est ainsi que l’on montre le drame de tout couple en train de se quitter : la difficulté de se comprendre, l’impossibilité de voir réellement l’autre et de laisser s’évanouir, voire déchirer, la construction idéale qu’on avait alimentée. Cocteau semble également mettre en avant comment, dans des conditions normales de communication, le téléphone envahit nos vies et comment, ainsi que l’expliquera par la suite Marshall Macluhan, cet outil « contrairement à l’écriture, et à l’imprimé, impose une participation totale »(19). Une participation qu’Anna Magnani interprétant ce rôle, comme une autre actrice italienne remarquable telle que Anna Proclamer dirigée par Giorgio Strehler, arrivent à porter sur scène grâce à leur incontestable présence scénique.
Le téléphone représente ainsi le pouvoir affabulateur des mots et la manière d’accéder à ce pouvoir pour en être le maître ou l’esclave. Mais il témoigne également les progrès médiatiques et le rêve tout humain d’arriver toujours plus loin, même dans les sentiments des autres personnes, grâce à des outils, ce qui relève d’une illusion, d’une utopie si on pense au dénouement choisi par Cocteau. Effacer techniquement les distances à travers le téléphone ne permet pas à la protagoniste d’atteindre avec son discours le cœur de son aimé. Cet outil ne peut pas se rendre autonome et prendre la place de l’amant : il est montré pour sa nature fragile, insuffisante, incapable de remplacer un véritable échange face à face. Cette femme sur le seuil de la mort est bien consciente des limites du medium mais aussi de son terrible potentiel et elle le souligne de manière manifeste lorsqu’elle dit : « Si tu ne m’aimais pas et si tu étais adroit, le téléphone deviendrait une arme effrayante, une arme qui ne laisse pas de traces, ne fait pas de bruit » (20). Une arme que l’on charge tous les jours et qui fait partie de notre arsenal domestique et identitaire : le téléphone comme un pistolet et les mots comme des balles aussi banales et ternies par l’usage que mortelles. Cocteau connait bien le pouvoir de ces munitions et il les pèse, il les choisit ou il les répète comme il le faisait dans certains de ses poèmes où la parole se répand, comme semée loin, déstructurée et pourtant significative. Dans son recueil Géorgiques funèbres par exemple, les versiculets à un seul mot soulignent une conception moderne de l’espace ; les vers se désarticulent et s’effilochent dans un univers abrupt qui s’écroule. Nous pensons que de manière analogue cette pièce accompagne la suicidée vers un gouffre, en accélérant son geste au fur et à mesure que ses mots se font mimésis d’une répétition obsédante ainsi que de l’asphyxie finale. On ne doit retenir que l’essentiel : en s’approchant de la fin de la pièce, les occurrences les plus fréquentes sont toutes afférentes au champ sémantique du mensonge. Cocteau cite l’illusion, l’imagination, le hasard et l’acte de mentir « par bonté » (21). Les mots de la vérité dont elle ne peut se passer ne sont pas toujours désintéressés et, parallèlement, les mensonges ne sont pas toujours un acte à reprocher. Le téléphone devrait encourager cette attitude de fausseté, de dissimulation et permettre de faire souffrir un peu moins cette amante trahie qui rêve d’un dernier signe d’attention passionné. Toutefois, ce mensonge ne sera pas prononcé et cette communication ne sera pas facile : dès le début un syntagme très rapide semble se faire métaphoriquement le commentaire synthétique du drame qui se joue dans l’âme de cette femme. Nous nous référons à la réplique du tout début de la conversation : « C’était un vrai supplice de t’entendre à travers tout ce monde » (22). Voici le sens de son geste funeste : la nécessité atroce d’apprendre à regarder son compagnon comme n’importe quelle autre personne, l’obligation de devenir pour lui une simple composante de ce « tout le monde », perdre son filtre privilégié de maîtresse. Ne plus pouvoir « entendre » est aussi métaphorique de la perte totale d’esprit, d’entendement, et le substantif supplice glose l’attitude de la femme sur scène.
Ainsi le téléphone, cet objet désormais si indispensable dans notre époque s’affichait déjà, il y a presque cent ans, à la fois comme un lien capable de réduire les écarts et comme une arme qui, bien utilisée, aurait pu sauver tout comme véhiculer le verdict : un instrument qui permet à l’actrice de construire son désespoir et ses moments fugaces de consolation. Autant que les mots, véritables pistolets dans nos mains, le téléphone aussi est une arme blanche mortelle, qui semble la secouer par de véritables coups à chaque fois que la communication est interrompue.
La femme déchirée, au sujet du fil du téléphone dira que « c’est le dernier qui me rattache encore à nous » (23), ce qui rappelle comment la distance annulée autrefois par le téléphone et aujourd'hui par des écrans ne peut pourtant soigner une âme qui se sent seule, qui ne rencontre qu’une bouche virtuelle muette confirmant sa solitude. En ce sens, Cocteau est pionnier dans l'attribution aux médias d'un rôle d'intermédiaire dans un rapport amoureux, un medium qui, dans ce cas, accompagne vers l’épilogue tragique. La voix de la femme, non son visage, que l'on voit pleurer, crier et gémir, affirme : « mais j’avais le téléphone dans mon lit et malgré tout, on est relié par téléphone... Parce que tu me parles »... comme si le téléphone avait pu, en objet miraculeux et fétiche, manifester ce qui était autrefois l’haleine divine de l’être aimé, la voix filtrant par le récepteur comme celle écoutée en posant son oreille (24) sur la poitrine de l’homme. D’après Claude Burgelin, cette femme reconnaît non seulement sa dépendance amoureuse mais aussi l’impossibilité de se séparer du téléphone (25) et c’est exclusivement au moment où elle réalise l’insuffisance de ce dernier, qu’elle décide de le faire disparaitre avec elle : il devient inutile puisque il ne lui ramènera pas l’objet de son amour. Et en prononçant ses derniers mots, les derniers de la pièce, elle n’attend même plus le temps d’entendre les réponses de son amant. Ce dernier, d’ailleurs, n’est plus son aimé : il est devenu, au fil des heures, un simple interlocuteur et cela lui est insupportable.
Ainsi fige-t-elle le moment de l’abandon en essayant de l’effacer par la répétition machinale du dernier mot de la pièce qui devrait symboliquement bloquer tout changement, affichant comme la seule vérité éternelle son « je t’aime », qui doit rester comme le seul souvenir pour l’amant et pour le spectateur.
L’anatomie d’un monologue : suicide solitaire prolongé sur scène
Si en général Cocteau considérait le style comme « une façon très simple de dire des choses très compliquées […] une manière d’épauler, de viser, de tirer vite et juste » (26), cette pièce respecte dans le lexique et dans la logique d’essentialité de ses répliques la volonté de tirer avec franchise et précision, pour arriver à tuer son personnage sans bavure. Les premiers signaux que la fin, recherchée la veille par la protagoniste en avalant une dose excessive de somnifère, sera cette fois très proche est donné par la réplique « Ce qui est dur c’est de raccrocher, de faire le noir » (27). Pas de tournure obscure, ni de mystère ou jeu anagrammatique comme dans Orphée ; ici la Voix est cristalline et on commence à soupçonner qu’elle prendra une décision tragique lorsqu’après quelques minutes elle définit explicitement la valeur de leur lien, une valeur très fragile, invisible, artificielle, comme le fil du téléphone : « comprends moi, je souffre, je souffre. Ce fil, c’est le dernier qui me rattache encore à nous… […] j’avais le téléphone dans mon lit, parce que malgré tout, on est reliés par le téléphone » (28). À partir de ce moment, le discours monte ses gammes tragiques pour faire envisager l’impossibilité de vivre de cette femme : le fil se transforme en tuyau vital d’un plongeur sous-marin, le sommeil où elle repêche ses images métaphoriques permet le transfert vers la figuration de la mort, une fin qui est d’ailleurs évoquée sans euphémisme : « Voilà cinq ans que je vis de toi, que tu es mon seul air respirable, que je passe mon temps à t’attendre, à te croire mort si tu es en retard, à mourir de te croire mort, à revivre si tu entres et quand tu es là enfin, à mourir de peur que tu partes. Maintenant j’ai de l’air parce que tu me parles. Mon rêve n’est pas si bête. Si tu coupes, tu coupes le tuyau… » (29). C’est à plus des trois quarts de la longueur de la pièce qui se joue que ce moment clé laisse comprendre le dénouement, c’est à partir de ce moment que cette femme dont on ne connaît pas le nom alors que paradoxalement on apprend celui de sa meilleure amie, Marthe, se compare aux animaux. À un poisson incapable d’« arranger sa vie sans l’eau » (30), au chien devenu hargneux, ne voulant plus manger ni être touché. Un animal blessé qui ne peut que se comporter de manière évidente et faire comprendre la réalité par son attitude souffrante. Et à partir de là, la sincérité se révèle comme le contrepoint de tout ce monologue, joué entre deux extrêmes autant désirés que craints : le mensonge et la vérité. Si au début la protagoniste avait essayé de cacher sa tentative de suicide de la veille, avait feint la bonne humeur et ensuite avait avoué son geste et son état fiévreux, à peu de minutes de la fin, parmi les silences, les hésitations, les brisures et les répétitions qui caractérisent toute la pièce, la vérité émerge dans sa qualification funeste la plus forte et elle ne peut qu’annoncer « Un air de condoléances ». Connaître et prononcer la vérité signifie, en d’autres termes, aider la protagoniste à mourir, l’accompagner vers sa fin et même à ce moment, c’est le téléphone qui permet d’accepter la vérité, en se substituant à la vue : ce medium permet mais entrave à la fois. Il fabrique un ersatz de présence, une présence devinée et reconstruite de cet absent qui s’estompe à jamais. À ce sujet l’auteur est très clair : « Un regard pouvait changer tout. Mais avec cet appareil, ce qui est fini, est fini » (31). C’est bien là que la décision est prise, mais également niée pour ne pas être arrêtée : la femme prononce calmement sa résolution en la niant : « Sois tranquille. On ne se suicide pas deux fois […] Où trouverai-je la force de combiner un mensonge, mon pauvre adoré ». Elle se contredit, elle prononce désormais un fleuve de mots incontrôlés qui évoquent l’une des devises parmi les plus célèbres de Cocteau : « Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité » (32). Elle sait construire une petite farce et essaye de tranquilliser son interlocuteur, de minimiser sa tentative de suicide, en commençant à se retirer du monde, à nier les choses : « parce que les choses que je n’imagine pas n’existent pas, ou bien, elles existent dans une espèce de lieu très vague et qui fait moins mal » (33). C’est presque la dernière minute de la pièce : sa supplication finale, prononcée le téléphone dans les bras et le fil autour du cou, réclament le contraire de ce qu’elle désire : « Dépêche-toi. Vas-y. Coupe ! Coupe vite ! Coupe ! ».
Pas de promesse ou d’autre explication : le moment venu, elle ne revient plus en arrière. Pour ne pas se tuer, il faut savoir apprendre à souffrir et cette femme vivait, même au cours de son histoire d’amour, côtoyant la mort, dans le totalitarisme de sa menace : son amant était son air et son eau, son souffle tout comme ses yeux et c’est seulement en coupant ce souffle qu’elle peut se livrer à l’éternité de son amour.
Pas de promesse ou d’autre explication : le moment venu, elle ne revient plus en arrière. Pour ne pas se tuer, il faut savoir apprendre à souffrir et cette femme vivait, même au cours de son histoire d’amour, côtoyant la mort, dans le totalitarisme de sa menace : son amant était son air et son eau, son souffle tout comme ses yeux et c’est seulement en coupant ce souffle qu’elle peut se livrer à l’éternité de son amour.
Acte de résistance ou vœu de docilité absolue ?
Ce qu’on appelle une raison de vivre est en même temps une excellente raison de mourir
Albert Camus (34)
Je ne redoute pas la mort. Elle est comme une naissance à l’envers
Jean Cocteau (35)
La Voix humaine, nous le soulignons, avait été créé expressément pour l’actrice Berthe Bovy et pour la simplicité esthétique des scènes des années 30. Pourtant le texte affiche une modernité éblouissante. Le recours constant aux trous, aux phrases morcelées, les pages parsemées de pointillés (36) polysémiques servent à délégitimer les mots, comme pour montrer que devant le grand choix de la mort il n’y a aucune rhétorique qui puisse consoler ou dissuader. De plus, les coupures se prêtent à mimer la respiration de plus en plus affaiblie de la femme en train de s’étrangler avec ce fil d’Ariane qui ne la conduit pas hors du labyrinthe de son drame d’amour. Mais il est aussi vrai que ce procédé stylistique contribue, d’après nous, à charger les mots plutôt que la phrase de sa valeur pleine, isolant leur pouvoir de désignation et attribuant à chaque syllabe décousue une charge d’angoisse. Le don verbal extraordinaire de l’auteur lui permettant de trouver toujours la formulation aphoristique la plus élégante lui sert ici pour égrainer le langage et s’appuyer sur ses unités, en décomposant tout d’abord la faculté langagière de cette femme avant de la faire disparaître une fois atteint le sommet de sa déclaration d’amour éternel.
Jugée par la critique facile à mettre en scène, économiquement très légère mais également riche d’une tradition de versions représentées avec succès, cette pièce constitue la gloire et le défi des futures actrices désirant prouver leur force dramatique sur la scène d’un meurtre domestique qui n’a rien de spécial et pourtant est si humain.
Adriana Asti, actrice italienne qui, dirigée par Benoit Jacquot lors de l’édition de 2013 du Festival dei due mondi de Spoleto, amena sur scène le drame amoureux de cette femme universelle de manière remarquable, remarque qu’il s’agit d’un désespoir inchangé depuis des siècles, même si les femmes d’aujourd’hui seraient, d’après elles, capables de le traverser autrement, ayant accès à de nouvelles ressources. Elle souligne également que cette victime cocteauienne semble afficher une certaine complaisance. Est-elle vraiment arrivée à se donner la mort pour ne plus avoir à imaginer son existence sans son amour, ou est-elle la seule et véritable maîtresse du jeu, capable de faire valoir sa vision absolue de la vie et de l’amour ? Son geste mortel est-il une offre sacrificielle, le geste d’une martyre, une toute dernière déclaration d’amour ou plutôt une trace de résistance, de son désir d’imposer sa vision du réel ? Les deux directions sont possibles, d’ailleurs chaque silence tout comme chaque mot est instrumentalisé par sa bouche pour les retourner dans tous les sens et même les contredire et, nous insistons à ce sujet, elle le fait à propos des vides aussi, les changeant dans les énoncés qu’elle désirerait prononcer et entendre. Le vœu de docilité est ainsi bien plus probable, puisque l’auteur signalait dès le début que la femme est amoureuse d’un bout à l’autre et que c’est une femme médiocre, s’attendant au secours d’un mensonge pour calmer sa douleur, la dernière tentative étant destinée à effacer par la fiction « ce souvenir mesquin » (37) de la trahison.
Mesquin et médiocre, tous les éléments de la pièce doivent l’être, comme le soulignent Georges Boulakia et Emma Galazzi analysant la version cinématographique de Roberto Rossellini dans une interprétation d’Anna Magnani qui frôle la perfection. Lorsqu’on regarde les yeux écarquillés d’Anna Magnani ou son attitude d’animal blessé, on ne pense en aucune manière à un vœu de docilité bien qu’elle prononce les mêmes phrases que la mélancolique Anna Proclamer ou qu’elle affiche par moment la même attitude grotesque que presque toutes les interprètes de cette Voix ont dû simuler. Anna Magnani est, parmi toutes les versions, la seule voix humaine cinématographique à pouvoir être considérée comme un véritable animal fabuleux, la seule capable de donner lieu avec cette intensité à la peur angoissée et à la haine masquée (38) causées par la perte de cet amour aveugle.
Nous avons conclu en évoquant la performance d’Anna Magnani pour rappeler que Cocteau lui-même considérait cette pièce comme un texte-prétexte, « un prétexte pour une actrice » (39). C’est le seul élément véritablement indispensable pour jouer ce drame : une formidable prima donna. Foin des nuisettes au blanc candide, foin des gants ou du téléphone : sans une actrice de grand talent, cette pièce se résoudrait dans l’illisible chronique d’un fait divers extrêmement pathétique et démodé comme peut l’être le suicide par amour. Cocteau voulait nous montrer que l’amour est un jeu qui se joue à deux ; lorsqu’on joue solo, on a perdu non seulement la confrontation avec un adversaire-complice mais aussi une partie de soi-même. En refusant de faire le deuil de son amour fini, cette femme impose que le public fasse le sien et réalise la seul chose qui compte dans l’art : faire toucher du doigt une émotion, arracher le jugement et le remplacer par le sentiment, comme pour la protagoniste de l’autre pièce coctauienne, La Dame à la Licorne, dont l’auteur affirmait, enthousiaste et touché : « sa mort émeut » (40).
Emanuela, NANNI
Albert Camus (34)
Je ne redoute pas la mort. Elle est comme une naissance à l’envers
Jean Cocteau (35)
La Voix humaine, nous le soulignons, avait été créé expressément pour l’actrice Berthe Bovy et pour la simplicité esthétique des scènes des années 30. Pourtant le texte affiche une modernité éblouissante. Le recours constant aux trous, aux phrases morcelées, les pages parsemées de pointillés (36) polysémiques servent à délégitimer les mots, comme pour montrer que devant le grand choix de la mort il n’y a aucune rhétorique qui puisse consoler ou dissuader. De plus, les coupures se prêtent à mimer la respiration de plus en plus affaiblie de la femme en train de s’étrangler avec ce fil d’Ariane qui ne la conduit pas hors du labyrinthe de son drame d’amour. Mais il est aussi vrai que ce procédé stylistique contribue, d’après nous, à charger les mots plutôt que la phrase de sa valeur pleine, isolant leur pouvoir de désignation et attribuant à chaque syllabe décousue une charge d’angoisse. Le don verbal extraordinaire de l’auteur lui permettant de trouver toujours la formulation aphoristique la plus élégante lui sert ici pour égrainer le langage et s’appuyer sur ses unités, en décomposant tout d’abord la faculté langagière de cette femme avant de la faire disparaître une fois atteint le sommet de sa déclaration d’amour éternel.
Jugée par la critique facile à mettre en scène, économiquement très légère mais également riche d’une tradition de versions représentées avec succès, cette pièce constitue la gloire et le défi des futures actrices désirant prouver leur force dramatique sur la scène d’un meurtre domestique qui n’a rien de spécial et pourtant est si humain.
Adriana Asti, actrice italienne qui, dirigée par Benoit Jacquot lors de l’édition de 2013 du Festival dei due mondi de Spoleto, amena sur scène le drame amoureux de cette femme universelle de manière remarquable, remarque qu’il s’agit d’un désespoir inchangé depuis des siècles, même si les femmes d’aujourd’hui seraient, d’après elles, capables de le traverser autrement, ayant accès à de nouvelles ressources. Elle souligne également que cette victime cocteauienne semble afficher une certaine complaisance. Est-elle vraiment arrivée à se donner la mort pour ne plus avoir à imaginer son existence sans son amour, ou est-elle la seule et véritable maîtresse du jeu, capable de faire valoir sa vision absolue de la vie et de l’amour ? Son geste mortel est-il une offre sacrificielle, le geste d’une martyre, une toute dernière déclaration d’amour ou plutôt une trace de résistance, de son désir d’imposer sa vision du réel ? Les deux directions sont possibles, d’ailleurs chaque silence tout comme chaque mot est instrumentalisé par sa bouche pour les retourner dans tous les sens et même les contredire et, nous insistons à ce sujet, elle le fait à propos des vides aussi, les changeant dans les énoncés qu’elle désirerait prononcer et entendre. Le vœu de docilité est ainsi bien plus probable, puisque l’auteur signalait dès le début que la femme est amoureuse d’un bout à l’autre et que c’est une femme médiocre, s’attendant au secours d’un mensonge pour calmer sa douleur, la dernière tentative étant destinée à effacer par la fiction « ce souvenir mesquin » (37) de la trahison.
Mesquin et médiocre, tous les éléments de la pièce doivent l’être, comme le soulignent Georges Boulakia et Emma Galazzi analysant la version cinématographique de Roberto Rossellini dans une interprétation d’Anna Magnani qui frôle la perfection. Lorsqu’on regarde les yeux écarquillés d’Anna Magnani ou son attitude d’animal blessé, on ne pense en aucune manière à un vœu de docilité bien qu’elle prononce les mêmes phrases que la mélancolique Anna Proclamer ou qu’elle affiche par moment la même attitude grotesque que presque toutes les interprètes de cette Voix ont dû simuler. Anna Magnani est, parmi toutes les versions, la seule voix humaine cinématographique à pouvoir être considérée comme un véritable animal fabuleux, la seule capable de donner lieu avec cette intensité à la peur angoissée et à la haine masquée (38) causées par la perte de cet amour aveugle.
Nous avons conclu en évoquant la performance d’Anna Magnani pour rappeler que Cocteau lui-même considérait cette pièce comme un texte-prétexte, « un prétexte pour une actrice » (39). C’est le seul élément véritablement indispensable pour jouer ce drame : une formidable prima donna. Foin des nuisettes au blanc candide, foin des gants ou du téléphone : sans une actrice de grand talent, cette pièce se résoudrait dans l’illisible chronique d’un fait divers extrêmement pathétique et démodé comme peut l’être le suicide par amour. Cocteau voulait nous montrer que l’amour est un jeu qui se joue à deux ; lorsqu’on joue solo, on a perdu non seulement la confrontation avec un adversaire-complice mais aussi une partie de soi-même. En refusant de faire le deuil de son amour fini, cette femme impose que le public fasse le sien et réalise la seul chose qui compte dans l’art : faire toucher du doigt une émotion, arracher le jugement et le remplacer par le sentiment, comme pour la protagoniste de l’autre pièce coctauienne, La Dame à la Licorne, dont l’auteur affirmait, enthousiaste et touché : « sa mort émeut » (40).
Emanuela, NANNI
Notes et bibliographie
(1) Francis Ramirez et Christian Rolot, Notice à i[La Voix humaine], dans Jean Cocteau, Théâtre Complet, Paris, Gallimard, 2003, p. 1679.
(2) Paul Valéry, «Choses tues», Tel quel, Paris, Gallimard, 1943, p. 61.
(3) Jean Cocteau, Préface, La Voix humaine, Théâtre Complet, i[op. cit.]i, p. 448.
(4) Francis Ramirez et Christian Rolot, i[op. cit.]i, p. 1679.
(5) Francis Ramirez et Christian Rolot, op. cit., p. 1676.
(6)Jean Cocteau, Préface II (écrite au théâtre), i[Les Parents terribles], dans Théâtre Complet, i[op. cit.], p. 677.
(7) Ibid., p. 678
(8) David Gulletops et Malou Haine, Jean Cocteau, textes et musiques, Bruxelles, Mardaga, 2005, p. 68.
(9) Jean Cocteau, La Voix humaine, op. cit., p. 447.
(10) Ibid., p. 451.
(11) Francis Ramirez et Christian Rolot, op. cit., p. 1677.
(12) Ibidem.
(13) Jean Cocteau, Préface II, op. cit., p. 678.
(14) Ibid., p. 681.
(15) Jean Cocteau cité par Marie Anne GUERIN, dans « Coctalk : la voix humaine », Catalogue de l’exposition « Jean Cocteau, sur le fil du siècle », Paris, Centre Pompidou, 2003, p.75.
(16) Voir à ce propos encore une fois les indications des Parents Terribles : « Au fond, à droite, de face aussi, porte de la salle de bains, qu’on devine blanche et très éclairée », Jean Cocteau, Préface II, op. cit., p. 681.
(17) Jean Cocteau, Préface, La Voix humaine, op. cit., p. 451.
(18) Ibidem.
(19) Marshall Macluan, Pour comprendre les média, Paris, Seuil, 1964, p. 377.
(20) Jean Cocteau, La Voix humaine, op. cit., p. 457.
(21) Ibid., p. 465.
(22) Ibid., p. 452.
(23) Ibid., p. 461.
(24) Ibid., p. 460.
(25) Claude Burgelin, Lire Cocteau, op. cit., p. 87.
(26) Jean Cocteau, [Le Secret professionnel]i, Poésie critique, Paris, Gallimard, 1959, p. 17.
(27) Jean Cocteau, La Voix humaine, op. cit., p. 459.
(28) Ibid., p. 461.
(29) Ibidem.
(30) Ibid., p. 462.
(31) Ibid., p. 464.
(32) Jean Cocteau, Journal d’un Inconnu, Paris, 1953, p. 16.
(33) Jean Cocteau, La Voix humaine, op. cit., p. 466-467.
(34)Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, collection « Idées », 1942 (édition 1962), p. 16.
(35) Entretien avec Roger Stéphane, publié en 1964.
(36)Voir Marc Paquien, Note d’intention http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/La-Voix-humaine/ensavoirplus/
(37) Jean Cocteau, La Voix humaine, op. cit., p. 452.
(38)Voir Georges Boulakia et Enrica Galazzi, « Voix et émotions dans une interprétation italienne filmée du texte de La Voix humaine de Jean Cocteau (Anna Magnani dans « Una voce umana » de Roberto Rossellini) », Lingua, cultura e testo. Miscellanea di studi francesi in onore di Sergio Cigada,Volume I, Milano, Vita e Pensiero, 2003, p. 137.
(39) Jean Cocteau, La Voix humaine, op. cit., p. 448.
(40) Ibid., p. 1611.
Bibliographie
BOULAKIA Georges et Enrica GALAZZI, « Voix et émotions dans une interprétation italienne filmée du texte de La Voix humaine de Jean Cocteau (Anna Magnani dans « Una voce umana » de Roberto Rossellini) », Lingua, cultura e testo. Miscellanea di studi francesi in onore di Sergio Cigada, Volume I, Milano, Vita e Pensiero, 2003, p. 133-152.
CHAILLEY Jacques, Notice à La Dame à la Licorne, Théâtre Complet, Paris, Gallimard, 2003, p. 1672-1675.
CAMUS Albert, Le Mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, collection « Idées », 1942 (édition 1962).
COCTEAU Jean, Journal d’un inconnu, Paris, 1953.
COCTEAU Jean, Le Secret professionnel, Poésie critique, Paris, Gallimard, p. 1959.
COCTEAU Jean, Préface, La Voix humaine, Théâtre Complet, Paris, Gallimard, 2003.
GUERIN Marie Anne, « Coctalk : la voix humaine », Catalogue de l’exposition « Jean Cocteau, sur le fil du siècle », Paris, Centre Pompidou, 2003, p. 73-78.
GULLETOPS David et Malou HAINE, Jean Cocteau, textes et musiques, Bruxelles, Mardaga, 2005.
MACLUHAN Marshall, Pour comprendre le média, Paris, Seuil, 1964.
PAQUIEN Marc, Note d’intention,
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/La-Voix-humaine/ensavoirplus/ (consulté le 28 avril 2015).
RAMIREZ Francis et Christian ROLOT, Notice à La Voix humaine, Théâtre Complet, Paris, Gallimard, 2003, p. 1675-1682.
VALÉRY Paul, « Choses tues », Tel quel, Paris, Galimard, 1943.
(2) Paul Valéry, «Choses tues», Tel quel, Paris, Gallimard, 1943, p. 61.
(3) Jean Cocteau, Préface, La Voix humaine, Théâtre Complet, i[op. cit.]i, p. 448.
(4) Francis Ramirez et Christian Rolot, i[op. cit.]i, p. 1679.
(5) Francis Ramirez et Christian Rolot, op. cit., p. 1676.
(6)Jean Cocteau, Préface II (écrite au théâtre), i[Les Parents terribles], dans Théâtre Complet, i[op. cit.], p. 677.
(7) Ibid., p. 678
(8) David Gulletops et Malou Haine, Jean Cocteau, textes et musiques, Bruxelles, Mardaga, 2005, p. 68.
(9) Jean Cocteau, La Voix humaine, op. cit., p. 447.
(10) Ibid., p. 451.
(11) Francis Ramirez et Christian Rolot, op. cit., p. 1677.
(12) Ibidem.
(13) Jean Cocteau, Préface II, op. cit., p. 678.
(14) Ibid., p. 681.
(15) Jean Cocteau cité par Marie Anne GUERIN, dans « Coctalk : la voix humaine », Catalogue de l’exposition « Jean Cocteau, sur le fil du siècle », Paris, Centre Pompidou, 2003, p.75.
(16) Voir à ce propos encore une fois les indications des Parents Terribles : « Au fond, à droite, de face aussi, porte de la salle de bains, qu’on devine blanche et très éclairée », Jean Cocteau, Préface II, op. cit., p. 681.
(17) Jean Cocteau, Préface, La Voix humaine, op. cit., p. 451.
(18) Ibidem.
(19) Marshall Macluan, Pour comprendre les média, Paris, Seuil, 1964, p. 377.
(20) Jean Cocteau, La Voix humaine, op. cit., p. 457.
(21) Ibid., p. 465.
(22) Ibid., p. 452.
(23) Ibid., p. 461.
(24) Ibid., p. 460.
(25) Claude Burgelin, Lire Cocteau, op. cit., p. 87.
(26) Jean Cocteau, [Le Secret professionnel]i, Poésie critique, Paris, Gallimard, 1959, p. 17.
(27) Jean Cocteau, La Voix humaine, op. cit., p. 459.
(28) Ibid., p. 461.
(29) Ibidem.
(30) Ibid., p. 462.
(31) Ibid., p. 464.
(32) Jean Cocteau, Journal d’un Inconnu, Paris, 1953, p. 16.
(33) Jean Cocteau, La Voix humaine, op. cit., p. 466-467.
(34)Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, collection « Idées », 1942 (édition 1962), p. 16.
(35) Entretien avec Roger Stéphane, publié en 1964.
(36)Voir Marc Paquien, Note d’intention http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/La-Voix-humaine/ensavoirplus/
(37) Jean Cocteau, La Voix humaine, op. cit., p. 452.
(38)Voir Georges Boulakia et Enrica Galazzi, « Voix et émotions dans une interprétation italienne filmée du texte de La Voix humaine de Jean Cocteau (Anna Magnani dans « Una voce umana » de Roberto Rossellini) », Lingua, cultura e testo. Miscellanea di studi francesi in onore di Sergio Cigada,Volume I, Milano, Vita e Pensiero, 2003, p. 137.
(39) Jean Cocteau, La Voix humaine, op. cit., p. 448.
(40) Ibid., p. 1611.
Bibliographie
BOULAKIA Georges et Enrica GALAZZI, « Voix et émotions dans une interprétation italienne filmée du texte de La Voix humaine de Jean Cocteau (Anna Magnani dans « Una voce umana » de Roberto Rossellini) », Lingua, cultura e testo. Miscellanea di studi francesi in onore di Sergio Cigada, Volume I, Milano, Vita e Pensiero, 2003, p. 133-152.
CHAILLEY Jacques, Notice à La Dame à la Licorne, Théâtre Complet, Paris, Gallimard, 2003, p. 1672-1675.
CAMUS Albert, Le Mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, collection « Idées », 1942 (édition 1962).
COCTEAU Jean, Journal d’un inconnu, Paris, 1953.
COCTEAU Jean, Le Secret professionnel, Poésie critique, Paris, Gallimard, p. 1959.
COCTEAU Jean, Préface, La Voix humaine, Théâtre Complet, Paris, Gallimard, 2003.
GUERIN Marie Anne, « Coctalk : la voix humaine », Catalogue de l’exposition « Jean Cocteau, sur le fil du siècle », Paris, Centre Pompidou, 2003, p. 73-78.
GULLETOPS David et Malou HAINE, Jean Cocteau, textes et musiques, Bruxelles, Mardaga, 2005.
MACLUHAN Marshall, Pour comprendre le média, Paris, Seuil, 1964.
PAQUIEN Marc, Note d’intention,
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/La-Voix-humaine/ensavoirplus/ (consulté le 28 avril 2015).
RAMIREZ Francis et Christian ROLOT, Notice à La Voix humaine, Théâtre Complet, Paris, Gallimard, 2003, p. 1675-1682.
VALÉRY Paul, « Choses tues », Tel quel, Paris, Galimard, 1943.
Profile
Emanuela Nanni est Docteur en études italiennes auprès de l'Université Stendhal (Grenoble) après avoir soutenu une thèse sur la valeur révolutionnaire de la traduction poétique en Italie pendant les années 30 et 40 du XXe siècle, thèse sous la direction de Monsieur le Professeur Christophe Mileschi (Université Paris X, Nanterre).
Elle est également traductrice diplômée auprès de la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori(Université de Bologne, a été membre du laboratoire GERCI (Groupe d'études et de recherches sur la culture italienne) et est membre du laboratoire ILCEA auprès de l’Université Stendhal, Grenoble 3.
Actuellement Maître de conférence à l’Université Stendhal (Grenoble) elle enseigne la traduction spécialisée vers l’italien, la négociation multi-langue et la langue de spécialité. Elle s'intéresse à la poésie contemporaine dans toutes ses perspectives y compris les relations avec l'esthétique et l'histoire de la traduction, toujours selon une approche comparatiste. Parmi ses dernières publications, on compte un texte à caractère traductologique sur Thomas Sébillet et deux études sur la poésie d’expression française de Giorgio De Chirico.
Ses axes de recherche prennent en considération également la didactique de la traduction et l’étude de la langue de spécialité, notamment dans le domaine de la muséologie et du patrimoine culturel matériel et immatériel.
Elle collabore avec le poète, artiste et photographe Nicolò Cecchella dans des écrits d'esthétique et poésie (voir « Poesia contemporanea e fotografia: corpo poetico e nutrimento immaginifico », dans les Cahiers d'études italiennes, n°12, Ellug, Grenoble, 2011, p. 144-177).
Elle est également traductrice diplômée auprès de la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori(Université de Bologne, a été membre du laboratoire GERCI (Groupe d'études et de recherches sur la culture italienne) et est membre du laboratoire ILCEA auprès de l’Université Stendhal, Grenoble 3.
Actuellement Maître de conférence à l’Université Stendhal (Grenoble) elle enseigne la traduction spécialisée vers l’italien, la négociation multi-langue et la langue de spécialité. Elle s'intéresse à la poésie contemporaine dans toutes ses perspectives y compris les relations avec l'esthétique et l'histoire de la traduction, toujours selon une approche comparatiste. Parmi ses dernières publications, on compte un texte à caractère traductologique sur Thomas Sébillet et deux études sur la poésie d’expression française de Giorgio De Chirico.
Ses axes de recherche prennent en considération également la didactique de la traduction et l’étude de la langue de spécialité, notamment dans le domaine de la muséologie et du patrimoine culturel matériel et immatériel.
Elle collabore avec le poète, artiste et photographe Nicolò Cecchella dans des écrits d'esthétique et poésie (voir « Poesia contemporanea e fotografia: corpo poetico e nutrimento immaginifico », dans les Cahiers d'études italiennes, n°12, Ellug, Grenoble, 2011, p. 144-177).
Publications
- « Quelques réflexions sur l’auto-traduction poétique : entre poésie comme langue étrangère par excellence et auto-traduction poétique interlinéaire », dans « Atelier de traduction » n°7, 2007, Université de Suceava, Roumanie, p. 67-78. Version électronique consultable à l’adresse :
www.atelierdetraduction.usv.ro/ro/revista/REVISTA%207.pdf
- « Forme del contagio nel poeta-traduttore / traduttore poeta Valerio Magrelli », Actes du colloque “Dies Romanicus Turicensis”, Aachen, Shaker Verlag, 2012, p. 159-177.
Résumé et proposition initiale publiés à l’adresse : http://www.rose.uzh.ch/forschung/kongresse/diesromanicusturicensis/diesromanicusturicensisV2009/abstracts/Emanuela_Nanni.pdf
- « La poesia : voce acuta e sfaccettata degli anni violenti (dai primi anni ’60 alla fine degli anni ’70) » (à paraitre sur le site http://colloque-temps-revoltes.ens-lsh.fr/ de l’ENS de Lyon suite au colloque Littérature et « temps des révoltes » (Italie, 1967-1980). Les « années de plomb » dans la littérature italienne de 1967 à nos jours des 27, 28 et 29 novembre 2009, organisé par l’Ecole Normale Supérieure Lettres et sciences humaines de Lyon, l’Université Stendhal, Grenoble III et l’Université Pierre Mendès France, Grenoble 2).
- « La traduzione poetica : violazione dell’ortologia e infedeltà concessa », Atti del convegno Journée Internationales de la traduction, 2008, Université de Palerme, Palerme, Editrice Herbetia, 2009, p. 220-235.
- « La transitività tra parola e materia come dimensione della poesia di un pittore e fotografo : Nicolò Cecchella », ITALIES, n°13, Poeti d’oggi / Poètes italiens d’aujourd’hui, Université de Provence, Aix en Provence, 2009. Texte intégral disponible à l’adresse URL http://italies.revues.org/2737.
- Nicolò Cecchella et Emanuela Nanni, « Fotografia e poesia contemporanea: corpo poetico e nutrimento immaginifico », dans « Texte e image », Cahier d’études italiennes, n°12, 2010, Grenoble, Ellug, p. 147-177. Disponible à l’adresse URL : http://cei.revues.org/pdf/598 114 114.
- « Davide Maria Turoldo : poète des derniers de la terre », Regards sur la poésie du XXe siècle, tome 4, Namur, Presses universitaires de Namur /Éditions namuroises, coll. « Études et Essais », (sous presse) (15 pages).
- (Traduction, FR>IT) « A contretemps » tiré de Henri Meschonnic, Hugo, la poésie contre le maintien de l’ordre, Paris, Maisonneuve & Larose, 2002, pour la revue La Libellula n°3, décembre 2011, « Il mestiere perduto »
à consulter à l’adresse URL : http://www.lalibellulaitalianistica.it/blog/?page_id=1162#_Meschonnic.
- « Une voix presque mienne : la poésie en français de Rainer Maria Rilke et Samuel Beckett », (article soumis et accepté par le comité de lecture pour la publication des actes, après l’intervention du même titre.)
- « Le faire poétique : une « indisciplinarité » opérante pendant les années 30 et 40 du XXe siècle », Loxias, n°42, Doctoriales X, Nice, 15 septembre 2013, disponible à l’URL :
http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=7551
- « Tra versione e mimesi : la visione della traduzione di Thomas de Sébillet », Cahiers, n°17, « Traduire : pratiques, théories, témoignages en Italie et en France du Moyen Âge à nos jours », Grenoble, Ellug, 2013, p. 93-103.
- « Nature morte ou nature silencieuse ? De la poésie française de De Chirico et de son Stilleben en vers », Erta, n°6, 2014, « La nature morte », Université de Gdansk, 2014, p. 71-84.
- (Chapitre de livre) « Valerio Magrelli traduit Giorgio De Chirico : concordances et divergences dans les circuits visuels de ces deux auteurs » (pour le volume Traduire en poète, Université de Padoue, Champion, à paraitre en 2015).
- « L'épreuve de l'indicible chez Henri Cartier Bresson : faire signifier le monde dansses moments décisifs » (soumis au comité de sélection pour la publication des Actes de la journée d’étude interdisciplinaire L'Évolution de la langue et le traitement des« intraduisibles» au sein de la recherche organisée par le Laboratoire d’ethnoscénologie à Paris-Saint-Denis le 28 novembre 2014).
- « La traduction poétique pour faire tomber toutes les réticences du poète caché dans le passeur » (en préparation pour une publication en collaboration avec l’Université Paris-Ouest-Nanterre, à paraitre en mai 2016).
www.atelierdetraduction.usv.ro/ro/revista/REVISTA%207.pdf
- « Forme del contagio nel poeta-traduttore / traduttore poeta Valerio Magrelli », Actes du colloque “Dies Romanicus Turicensis”, Aachen, Shaker Verlag, 2012, p. 159-177.
Résumé et proposition initiale publiés à l’adresse : http://www.rose.uzh.ch/forschung/kongresse/diesromanicusturicensis/diesromanicusturicensisV2009/abstracts/Emanuela_Nanni.pdf
- « La poesia : voce acuta e sfaccettata degli anni violenti (dai primi anni ’60 alla fine degli anni ’70) » (à paraitre sur le site http://colloque-temps-revoltes.ens-lsh.fr/ de l’ENS de Lyon suite au colloque Littérature et « temps des révoltes » (Italie, 1967-1980). Les « années de plomb » dans la littérature italienne de 1967 à nos jours des 27, 28 et 29 novembre 2009, organisé par l’Ecole Normale Supérieure Lettres et sciences humaines de Lyon, l’Université Stendhal, Grenoble III et l’Université Pierre Mendès France, Grenoble 2).
- « La traduzione poetica : violazione dell’ortologia e infedeltà concessa », Atti del convegno Journée Internationales de la traduction, 2008, Université de Palerme, Palerme, Editrice Herbetia, 2009, p. 220-235.
- « La transitività tra parola e materia come dimensione della poesia di un pittore e fotografo : Nicolò Cecchella », ITALIES, n°13, Poeti d’oggi / Poètes italiens d’aujourd’hui, Université de Provence, Aix en Provence, 2009. Texte intégral disponible à l’adresse URL http://italies.revues.org/2737.
- Nicolò Cecchella et Emanuela Nanni, « Fotografia e poesia contemporanea: corpo poetico e nutrimento immaginifico », dans « Texte e image », Cahier d’études italiennes, n°12, 2010, Grenoble, Ellug, p. 147-177. Disponible à l’adresse URL : http://cei.revues.org/pdf/598 114 114.
- « Davide Maria Turoldo : poète des derniers de la terre », Regards sur la poésie du XXe siècle, tome 4, Namur, Presses universitaires de Namur /Éditions namuroises, coll. « Études et Essais », (sous presse) (15 pages).
- (Traduction, FR>IT) « A contretemps » tiré de Henri Meschonnic, Hugo, la poésie contre le maintien de l’ordre, Paris, Maisonneuve & Larose, 2002, pour la revue La Libellula n°3, décembre 2011, « Il mestiere perduto »
à consulter à l’adresse URL : http://www.lalibellulaitalianistica.it/blog/?page_id=1162#_Meschonnic.
- « Une voix presque mienne : la poésie en français de Rainer Maria Rilke et Samuel Beckett », (article soumis et accepté par le comité de lecture pour la publication des actes, après l’intervention du même titre.)
- « Le faire poétique : une « indisciplinarité » opérante pendant les années 30 et 40 du XXe siècle », Loxias, n°42, Doctoriales X, Nice, 15 septembre 2013, disponible à l’URL :
http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=7551
- « Tra versione e mimesi : la visione della traduzione di Thomas de Sébillet », Cahiers, n°17, « Traduire : pratiques, théories, témoignages en Italie et en France du Moyen Âge à nos jours », Grenoble, Ellug, 2013, p. 93-103.
- « Nature morte ou nature silencieuse ? De la poésie française de De Chirico et de son Stilleben en vers », Erta, n°6, 2014, « La nature morte », Université de Gdansk, 2014, p. 71-84.
- (Chapitre de livre) « Valerio Magrelli traduit Giorgio De Chirico : concordances et divergences dans les circuits visuels de ces deux auteurs » (pour le volume Traduire en poète, Université de Padoue, Champion, à paraitre en 2015).
- « L'épreuve de l'indicible chez Henri Cartier Bresson : faire signifier le monde dansses moments décisifs » (soumis au comité de sélection pour la publication des Actes de la journée d’étude interdisciplinaire L'Évolution de la langue et le traitement des« intraduisibles» au sein de la recherche organisée par le Laboratoire d’ethnoscénologie à Paris-Saint-Denis le 28 novembre 2014).
- « La traduction poétique pour faire tomber toutes les réticences du poète caché dans le passeur » (en préparation pour une publication en collaboration avec l’Université Paris-Ouest-Nanterre, à paraitre en mai 2016).