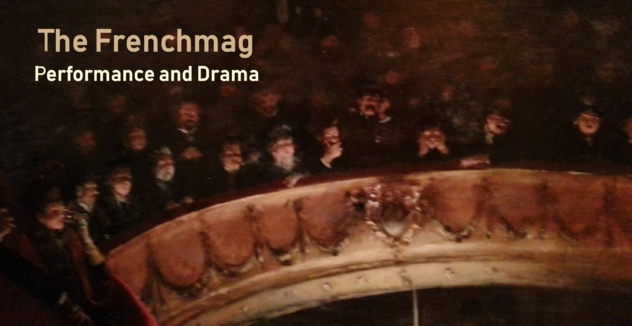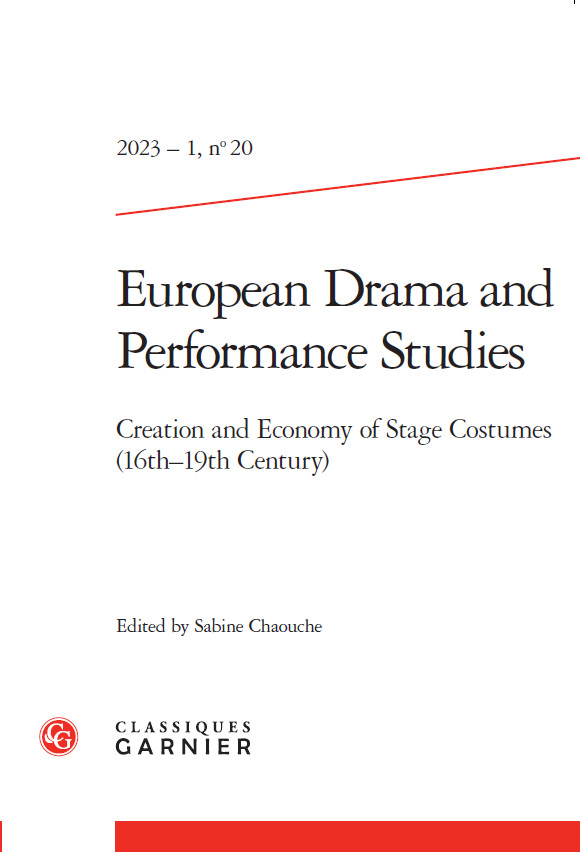Présentation de l'éditeur

De l’Âge classique jusqu’aux prémices de la modernité, le goût du merveilleux, du magique et du surnaturel est essentiel au spectacle théâtral.
Le présent ouvrage envisage les rapports entre le conte merveilleux et les arts du spectacle, allant des tragédies lyriques de la fin du XVIIe siècle aux féeries romantiques et aux premières tentatives cinématographiques du XIXe siècle. Contes de fées et contes orientaux collaborent activement à l’invention d’un merveilleux scénique, empruntant à la farce, à la sotie, à la parade, aux comédies allégoriques et jusqu’aux spectacles de lanternes magiques leurs dispositifs théâtralisés.
Comédie-Française, Théâtre-Italien, Foire et Boulevards accueillent Les Mille et Une Nuits, montent et remontent Le Petit Poucet ou Barbe bleue, leur inventant une oralité nouvelle et les colorant d’irrespect ou d’érotisme.
Déconstruction de l’illusion, subversion de la croyance, virtuosité dans l’artifice, jeu calculé avec les rêves du peuple et les projections des élites ; théâtre et conte n’auront jamais cessé de s’entendre pendant plus de trois siècles.
Cet ouvrage collectif réunit des chercheurs en histoire, littérature, esthétique et arts du spectacle autour de la présence du conte merveilleux sur la scène française. Martial Poirson est maître de conférences en littérature et arts du spectacle, spécialiste d’histoire et d’esthétique du théâtre, et travaille sur les transpositions théâtrales de conte. Jean-François Perrin est professeur en littérature française du XVIIIe siècle. Il dirige la revue Féeries et poursuit une recherche sur les contes orientalistes du XVIIIe siècle. Tous deux enseignent à l’Université Stendhal-Grenoble III et sont membres de l’UMR LIRE-CNRS.
Le présent ouvrage envisage les rapports entre le conte merveilleux et les arts du spectacle, allant des tragédies lyriques de la fin du XVIIe siècle aux féeries romantiques et aux premières tentatives cinématographiques du XIXe siècle. Contes de fées et contes orientaux collaborent activement à l’invention d’un merveilleux scénique, empruntant à la farce, à la sotie, à la parade, aux comédies allégoriques et jusqu’aux spectacles de lanternes magiques leurs dispositifs théâtralisés.
Comédie-Française, Théâtre-Italien, Foire et Boulevards accueillent Les Mille et Une Nuits, montent et remontent Le Petit Poucet ou Barbe bleue, leur inventant une oralité nouvelle et les colorant d’irrespect ou d’érotisme.
Déconstruction de l’illusion, subversion de la croyance, virtuosité dans l’artifice, jeu calculé avec les rêves du peuple et les projections des élites ; théâtre et conte n’auront jamais cessé de s’entendre pendant plus de trois siècles.
Cet ouvrage collectif réunit des chercheurs en histoire, littérature, esthétique et arts du spectacle autour de la présence du conte merveilleux sur la scène française. Martial Poirson est maître de conférences en littérature et arts du spectacle, spécialiste d’histoire et d’esthétique du théâtre, et travaille sur les transpositions théâtrales de conte. Jean-François Perrin est professeur en littérature française du XVIIIe siècle. Il dirige la revue Féeries et poursuit une recherche sur les contes orientalistes du XVIIIe siècle. Tous deux enseignent à l’Université Stendhal-Grenoble III et sont membres de l’UMR LIRE-CNRS.
Sommaire
PRÉFACE :
Les affinités électives du merveilleux et de la scène théâtrale française (XVIIe-XIXe siècles), par Martial Poirson
I. THÉÂTRALITÉ ET TRANSPOSITION DRAMATIQUE DU CONTE MERVEILLEUX
Raymonde ROBERT, « L’invasion de la scène par la féerie au XVIIIe siècle. Les avatars d’un conte : de Chaucer à Voltaire, de Voltaire à Favart et Voisenon »
Benjamin PINTIAUX, « Le conte, un opéra imaginaire »
Aurélia GAILLARD, « Le conte et ses machines : pour une esthétique de l’effet merveilleux »
Catherine RAMOND, « Les illustrations des Contes de Perrault de 1697 à 1785 : vers une « lecture spectacle » du conte »
Jean-François PERRIN, « Les machines de l’illusion au miroir du conte oriental chez Th.-S. Gueullette (Les Sultanes de Guzarate) et A. Galland (Histoire du dormeur éveillé) »
Martial POIRSON, « Le conte merveilleux, ouvroir de littérature dramatique potentielle : transpositions théâtrales du Petit Poucet »
Angela BRAITO, « Merveilleux scénique, enchantement et plaisir théâtral dans les pantomimes de La Belle au bois dormant de la seconde moitié du XVIIIe siècle (1700-1783)»
Isabelle MARTIN, « Du conte de fées aux limites du merveilleux et de l’étrangeté sur la scène foraine : monstres et êtres hybrides »
II. POÉTIQUE DU CONTE MERVEILLEUX THÉÂTRAL ET MUSICAL
Gaël LE CHEVALIER, « “J’ai pitié de l’erreur qui l’abuse” : l’enchantement retrouvé dans le théâtre du XVIIe siècle »
Christelle BAHIER-PORTE, « “Je crois que votre merveilleux est à fin de terme” : Mémoire du conte et dispositifs de l’enchantement dans le théâtre de Marivaux »
Aurélie ZYGEL-BASSO, « Un Barbe bleue troubadour. Voir et entendre le drame féerique chez Marillier, Sedaine et Grétry (1785-1789) »
Sabine GRUFFAT, « Les dieux de machines dans Isis de Lully et Quinault : fonctions et significations».
Jean-Philippe GROSPERRIN, « “De tes enchantements vois l’inutile usage”. Pour une dramaturgie de l’échec dans la tragédie lyrique »
Béatrice DIDIER, « Rameau ou le rationalisme enchanté. Magie et Raison dans les opéras de Rameau»
Pauline BEAUCE, « L’envers parodique du magicien d’opéra au XVIIIe siècle »
III. CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE RÉCEPTION DE L’ENCHANTEMENT
Ioana GALLERON, « La dramaturgie du merveilleux intellectualisée à la Cour de Sceaux »
Isabelle LIGIER-DEGAUQUE, « Dans les secrets de fabrication de l’enchantement à l’Opéra : réécritures parodiques des voleries et autres déplacements spectaculaires »
Damien CHARDONNET, « Sémiramis ou le retour délicat du merveilleux spectaculaire sur la scène institutionnelle de la Comédie-Française en 1748 »
Marianne BOUCHARDON, « Le décor de mélodrame et l’esthétique du sublime : l’“horreur délicieuse” comme école du spectateur »
Noémie COURTES, « “Véritable Jupin de l’Olympe dramatique”, le machiniste du XVIIe au XIXe siècle »
Guy SPIELMANN, « La féerie théâtrale (re) mise en scène dans l’œuvre cinématographique de “l’enchanteur” Méliès »
Les affinités électives du merveilleux et de la scène théâtrale française (XVIIe-XIXe siècles), par Martial Poirson
I. THÉÂTRALITÉ ET TRANSPOSITION DRAMATIQUE DU CONTE MERVEILLEUX
Raymonde ROBERT, « L’invasion de la scène par la féerie au XVIIIe siècle. Les avatars d’un conte : de Chaucer à Voltaire, de Voltaire à Favart et Voisenon »
Benjamin PINTIAUX, « Le conte, un opéra imaginaire »
Aurélia GAILLARD, « Le conte et ses machines : pour une esthétique de l’effet merveilleux »
Catherine RAMOND, « Les illustrations des Contes de Perrault de 1697 à 1785 : vers une « lecture spectacle » du conte »
Jean-François PERRIN, « Les machines de l’illusion au miroir du conte oriental chez Th.-S. Gueullette (Les Sultanes de Guzarate) et A. Galland (Histoire du dormeur éveillé) »
Martial POIRSON, « Le conte merveilleux, ouvroir de littérature dramatique potentielle : transpositions théâtrales du Petit Poucet »
Angela BRAITO, « Merveilleux scénique, enchantement et plaisir théâtral dans les pantomimes de La Belle au bois dormant de la seconde moitié du XVIIIe siècle (1700-1783)»
Isabelle MARTIN, « Du conte de fées aux limites du merveilleux et de l’étrangeté sur la scène foraine : monstres et êtres hybrides »
II. POÉTIQUE DU CONTE MERVEILLEUX THÉÂTRAL ET MUSICAL
Gaël LE CHEVALIER, « “J’ai pitié de l’erreur qui l’abuse” : l’enchantement retrouvé dans le théâtre du XVIIe siècle »
Christelle BAHIER-PORTE, « “Je crois que votre merveilleux est à fin de terme” : Mémoire du conte et dispositifs de l’enchantement dans le théâtre de Marivaux »
Aurélie ZYGEL-BASSO, « Un Barbe bleue troubadour. Voir et entendre le drame féerique chez Marillier, Sedaine et Grétry (1785-1789) »
Sabine GRUFFAT, « Les dieux de machines dans Isis de Lully et Quinault : fonctions et significations».
Jean-Philippe GROSPERRIN, « “De tes enchantements vois l’inutile usage”. Pour une dramaturgie de l’échec dans la tragédie lyrique »
Béatrice DIDIER, « Rameau ou le rationalisme enchanté. Magie et Raison dans les opéras de Rameau»
Pauline BEAUCE, « L’envers parodique du magicien d’opéra au XVIIIe siècle »
III. CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE RÉCEPTION DE L’ENCHANTEMENT
Ioana GALLERON, « La dramaturgie du merveilleux intellectualisée à la Cour de Sceaux »
Isabelle LIGIER-DEGAUQUE, « Dans les secrets de fabrication de l’enchantement à l’Opéra : réécritures parodiques des voleries et autres déplacements spectaculaires »
Damien CHARDONNET, « Sémiramis ou le retour délicat du merveilleux spectaculaire sur la scène institutionnelle de la Comédie-Française en 1748 »
Marianne BOUCHARDON, « Le décor de mélodrame et l’esthétique du sublime : l’“horreur délicieuse” comme école du spectateur »
Noémie COURTES, « “Véritable Jupin de l’Olympe dramatique”, le machiniste du XVIIe au XIXe siècle »
Guy SPIELMANN, « La féerie théâtrale (re) mise en scène dans l’œuvre cinématographique de “l’enchanteur” Méliès »